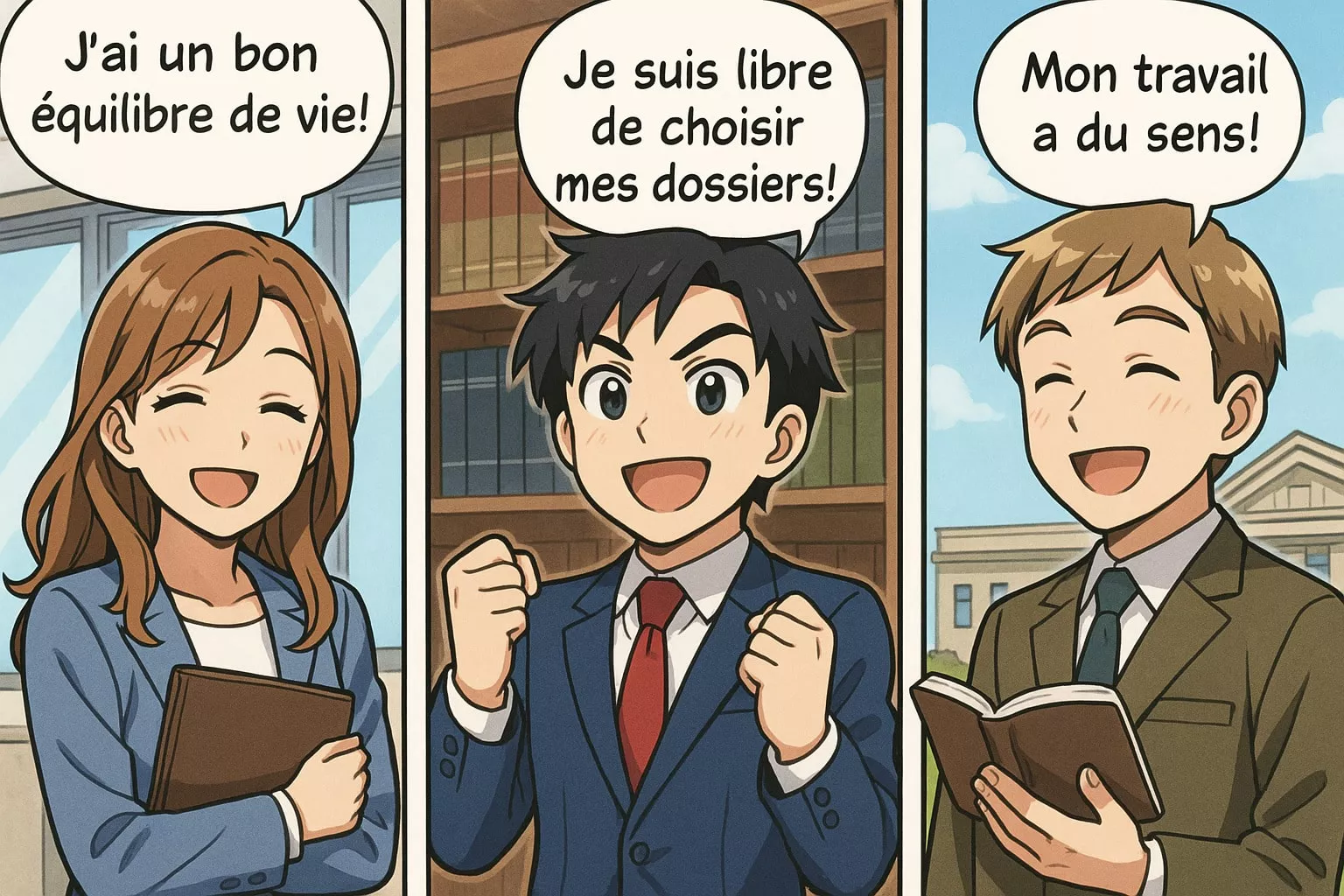Sans préjudice ?

Gérard Samet
2011-07-04 15:00:00
Le « waiver of tort »
Et voilà qu’un autre concept obscur de la common law, longtemps ignoré, est invoqué avec une fréquence accrue dans les demandes de recours collectif, qui occupent une part de plus en plus importante de l’environnement juridique canadien. Cette notion, c’est le « waiver of tort ».

Une révolution conceptuelle
Ce concept est à nouveau utilisé depuis le milieu des années 2000. Il constitue une sorte de révolution conceptuelle depuis que plusieurs recours collectifs - généralement en matière de responsabilité du fabricant - ont été certifiés sans que les demandeurs aient à justifier, pour engager leur action, de préjudice individuel lié à la faute. Ils n’ont donc pas eu à prouver, pour obtenir la certification de leur recours collectif, qu’ils se sont appauvris du fait de l’enrichissement de leur adversaire. Dans l’affaire ontarienne Serhan Estate c. Johnson & Johnson, une action en responsabilité du fabricant, les demandeurs se sont fondés sur la conduite transgressive alléguée de Johnson & Johnson, un grand fabricant de produits pharmaceutiques. Johnson & Johnson aurait commis plusieurs délits dans la fabrication, la vente et la distribution d’un produit appelé « SureStep System » que les diabétiques utilisent pour surveiller leur glycémie. Selon le groupe demandeur, cette firme aurait engagé sa responsabilité à l’égard de tout le groupe de consommateurs de certains de ses produits.

Dans l’affaire Heward c. Eli Lilly&Co, le même juge Cullity a certifié un autre recours collectif fondé sur la renonciation au délit civil. Selon le juge la question était de savoir si Eli Lilly & Co, un fabricant de médicaments antipsychotiques avait manqué à son obligation de prudence en cachant les effets secondaires nuisibles du médicament en cause, et si cette société avait eu l’intention de tirer profit de cette dissimulation et d’en toucher les bénéfices.
Et enfin dans Reid c. Ford Motor Company, la demanderesse a invoqué la renonciation au délit civil pour demander la restitution des gains réalisés par le constructeur automobile dans la commercialisation d’un interrupteur d’allumage, en alléguant que celui-ci le savait défectueux. La juge Gerow de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a certifié la demande de recours collectif fondée sur la faute intentionnelle et le délit d’enrichissement sans cause du constructeur, sans que la demanderesse justifie son propre appauvrissement causé par la faute alléguée. Le procès devra vérifier si le comportement fautif du défendeur et le gain qui en résulte suffiront à valider la demande, sans prouver la perte subie par la demanderesse.
L’affaire Pro-Sys Consultants c. Microsoft Corporation est une autre demande pendante, fondée sur le « waiver of tort », en matière de prix plus élevés facturés du fait d’agissements anticoncurrentiels.
Qu’en dit le plus haut tribunal du pays? Rien pour l’instant. La Cour suprême du Canada a refusé une demande d’autorisation d’appel dans l’affaire Serhan Estate. Validait-elle ainsi ce type de procédure?
Recours collectifs certifiés

Selon Me Lang, le concept de « waiver of tort », malgré sa récente popularité, est entouré de nombreuses interrogations qui ne sont pas encore résolues. « Est-ce une cause autonome d’action ou faut-il présenter une demande de dommages compensatoires fondés sur un délit distinct avant de pouvoir plaider le « waiver of tort? », s’interroge-t-elle. Peut-on obtenir la restitution des profits procurés par un acte répréhensible, indépendamment de tout lien de causalité prouvé entre l’appauvrissement du demandeur et l’enrichissement du défendeur? « Les tribunaux de common law ont décidé que ces questions relevaient de la discrétion judiciaire lors du procès. Ils ont néanmoins accepté de certifier les demandes de recours collectifs. Mais tous les recours certifiés fondés sur le « waiver of tort » ont été réglés, de sorte qu’aucun jugement n’a encore statué sur ces questions ».
Une influence au Québec?
Mais à elle seule, la certification des recours collectifs dans ce contexte suffit à s’interroger non seulement sur le potentiel de cette relative nouveauté en common law, mais aussi de son éventuelle portée sur la certification des recours collectifs dans le droit civil québécois.

Même son de cloche de la part de Jean St-Onge, associé à Lavery de Billy, et président du comité sur les recours collectifs du Barreau du Québec. Il avance que le rôle réparateur du recours collectif est contraire au « waiver of tort », une notion étrangère au droit civil. « L’utiliser différemment n’est pas souhaitable, ce n’est pas sa finalité. Mais on peut se poser la question sérieusement dans certaines situations où la faute est très grave, et où les dommages individuels sont très difficiles à prouver. On ne peut exclure une approche innovatrice dans le futur ».
Selon Yves Martineau, de Stikeman Elliot à Montréal, « il peut être dangereux d’extrapoler simplement et de rendre applicable au Québec la jurisprudence de l’Ontario ou de la Colombie-Britannique ». Son confrère Pierre Sylvestre, spécialiste montréalais des demandes en recours collectifs, est formel. « La notion de « waiver of tort » ne pourra pas s’appliquer au Québec », ni avoir une quelconque influence en droit civil. Dans cette notion de common law, « on abandonne les principes de la responsabilité civile », pour « une réclamation en fonction des profits » lorsqu’une faute a été commise. «Elle est fondée sur le caractère pragmatique de la common law », dont la « logique est différente de l’esprit cartésien du droit civil ». L’avocat estime néanmoins que « la common law et le droit civil parviennent souvent aux mêmes solutions concrètes par des raisonnements juridiques différents ».
Distinction civiliste


« Dans certains cas de gestes très lourds et difficiles à contester, il pourrait être utile d’utiliser les principes du « waiver of tort » pour ne pas laisser un défenseur indemne, sans pénaliser les droits de sa défense. C’est un mécanisme de rough justice que l’on utilise au Québec lorsque l’on règle avec une compagnie pharmaceutique. Le contournement des règles de causalité individuelles existe déjà en jurisprudence québécoise de façon indirecte », précise Me Bélanger, « lorsque le préjudice est calculé en fonction d’une moyenne d’un groupe. Les juges sont sensibles à ce genre d’approche ».
D’autres, par contre, sensibles aux références à la common law, préfèrent éviter les ingérences extérieures.