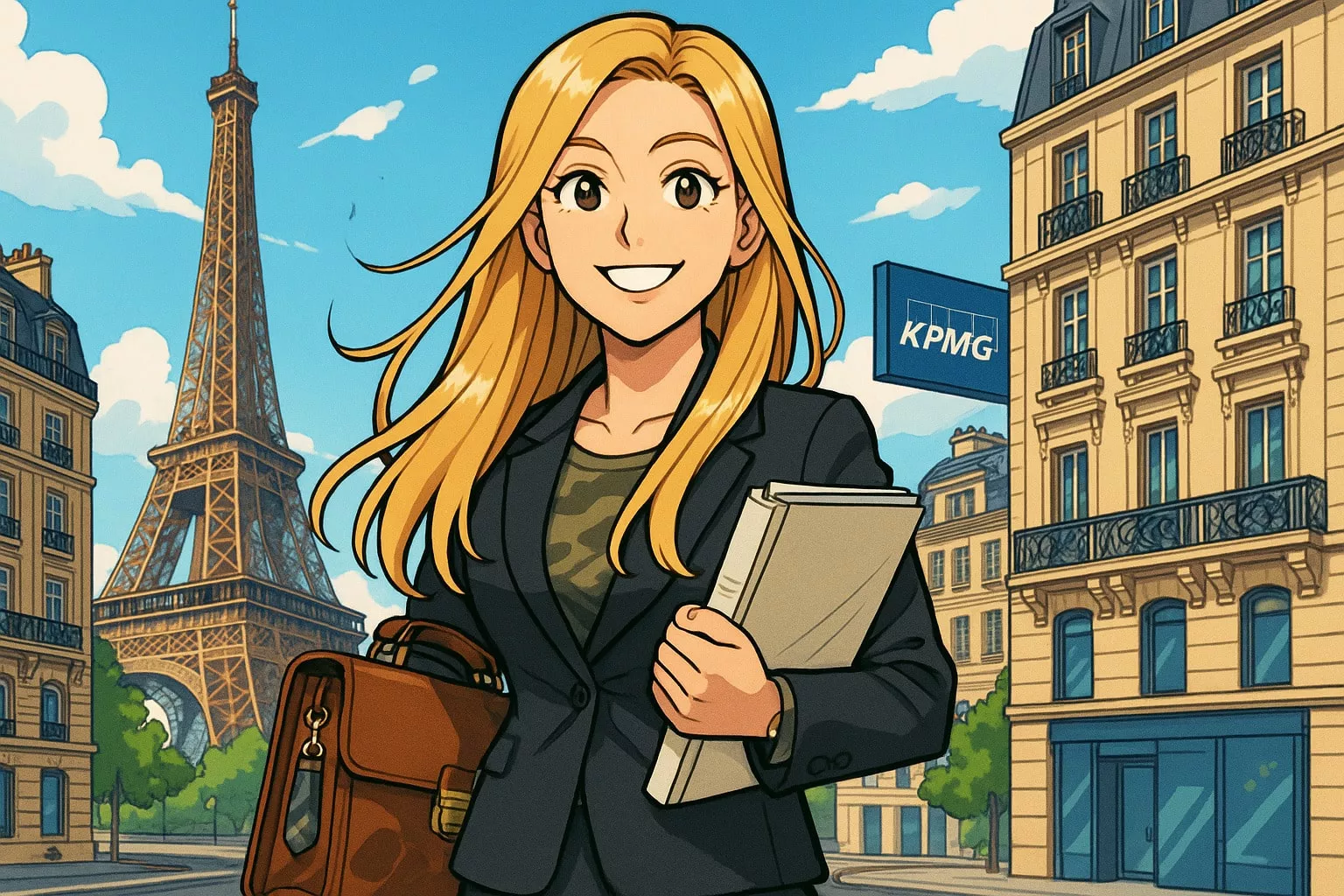Qui a raison?

L'équipe Droit-Inc
2009-04-23 14:00:00
À la suite de cette chronique, que vous pouvez lire en entier en cliquant ici, Louis P. Bélanger a rédigé une réplique, publiée aujourd’hui dans les pages Forum de La Presse.
Rappelons brièvement les faits.
Le juge Jean-François de Grandpré, de la Cour supérieure de Montréal, a émis une ordonnance contre le groupe Gesca et un journaliste du quotidien La Presse pour interdire la publication d'informations sur tout pourparlers tenu en dehors du cadre judiciaire.
Dans une poursuite civile à Montréal, le gouvernement fédéral tente de récupérer 35 millions de dollars qu'il réclame au Groupe Polygone dans le cadre des retombées du scandale des commandites. Ces dernières semaines, La Presse et la plupart des grands médias ont publié certains détails qui n'ont pas plu à la défense.
Les avocats de Polygone, dont Me Bélanger, ont demandé une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de toute information relative aux négociations de règlement qui pourraient intervenir entre leur client et le procureur général.
Le juge de Grandpré leur a donné raison; il interdit aux médias de briser la confidentialité de toute discussion.
Yves Boisvert convient que « En soi, ce n'est pas un jugement surprenant. Il est vrai que les règlements deviendraient difficiles si les négociations étaient sans cesse rapportées dans les médias. Il y a une réelle valeur à protéger ces négociations. »
Mais il ajoute : « Dans le cas de négociations impliquant les fonds publics, en marge du plus grand scandale politique des 10 dernières années, on peut plaider l'intérêt public. Si, par exemple, on apprend que le règlement risque de se faire pour une somme dérisoire. »
Voici la réplique de Louis P. Bélanger:
L'intérêt public n'est pas un élastique
Il ne justifie pas qu'on publie toutes les informations obtenues par un journaliste
Cher M. Boisvert, tout d'abord, il est pour le moins exagéré de prétendre que la décision du juge de Grandpré "rendrait illégales à peu près toutes les enquêtes journalistiques".
Cette décision s'inscrit dans un cadre bien défini, soit celui de négociations hors cour par les parties à un débat judiciarisé. Votre exemple du Watergate est une très mauvaise comparaison. Dans ce cas-là, le "scandale" n'avait pas encore été exposé publiquement. Dans le présent cas, le journaliste Daniel Leblanc du Globe and Mail s'en est chargé, comme vous le soulignez à juste titre.
Nous ne sommes donc plus dans une situation où le journalisme d'enquête aurait le mérite d'exposer une situation autrement inconnue dans l'intérêt public. Ici, il y a un débat judiciaire où les procédures sont publiques, tout comme le procès le serait. Le journalisme d'enquête a donc fait son travail. C'est maintenant aux journalistes couvrant la scène judiciaire de faire le leur et ils le font très bien.
Il est inexact de dire que le juge n'a pas "pris en considération les enjeux d'intérêt public". Ceux-ci ont été plaidés spécifiquement devant le juge de Grandpré. En reconnaissant la confidentialité des négociations hors cour, d'ailleurs consacrées législativement, le juge de Grandpré a reconnu qu'un droit, tout aussi important que la liberté d'expression, était ici en cause, soit celui du droit à la vie privée, consacré par la Charte des droits et libertés de la personne et le Code Civil du Québec.
Dans ce cas-ci, ce droit doit l'emporter. C'est ce qu'a reconnu la Cour suprême du Canada en décidant que des interrogatoires tenus hors cour et qui n'avaient pas encore été déposés au dossier de la cour devaient demeurer confidentiels et que les médias n'y avaient pas accès. L'intérêt public n'est pas un élastique que l'on peut étirer à l'infini pour justifier de publier toutes les informations obtenues par un journaliste. Même lorsque des fonds publics sont en cause, il existe certaines règles de confidentialité, telles le secret du fonctionnaire et celui de l'exécutif.
De prétendre que les médias doivent s'immiscer dans des négociations confidentielles pour s'assurer qu'un règlement ne se fera pas pour une somme dérisoire, c'est de donner aux médias un rôle qu'ils n'ont pas. Le débat est judiciarisé et des avocats représentent les parties qui sont aguerries. Ceux-ci connaissent, beaucoup mieux que les médias et le public, les forces et les faiblesses de la preuve et des arguments, de part et d'autres, pour évaluer de façon équitable ce qui peut constituer un règlement juste et raisonnable.
Le fait que le gouvernement soit l'une des parties qui négocie ne change donc rien au principe du caractère confidentiel de ces négociations. C'est ce que reconnaît le juge de Grandpré qui, en ce sens, a donné priorité à l'intérêt public pour le règlement des litiges versus le soi-disant intérêt public à négocier dans les médias.
Je tenais donc à vous rassurer, de même que vos lecteurs, à l'effet que le journalisme d'enquête est toujours bien vivant et ne sera pas affecté par ce jugement qui concerne une autre valeur toute aussi importante dans une société libre et démocratique, soit celle du droit à la vie privée, comprenant celui de négocier confidentiellement.
Louis P. Bélanger
‘’L'auteur est associé principal et chef du groupe national de litige du cabinet Stikeman Elliott. Il réplique à la chronique "Feu le journalisme d'enquête?" d'Yves Boisvert, publiée lundi dernier.’’
Et une sur-réplique d’Yves Boisvert!
Parfois, il le faut
Je ne vois pas comment on peut, à l'avance et pour l'éternité, interdire à un journaliste d'écrire sur des négociations (même confidentielles) impliquant le gouvernement et les fonds publics. On peut facilement imaginer des cas de figure où l'intérêt public commanderait d'alerter l'opinion.
Yves Boisvert
Bref, selon vous qui a raison? Et pourquoi?