Revenons aux fondements du droit

Amélia Salehabadi
2007-09-24 12:50:00
Je me passionne pour le droit, en particulier et surtout celui de notre province, car même si le Québec est de juridiction principalement civiliste, certains de ses champs de pratique sont régis par les principes de Common Law (i.e. le droit criminel ou une bonne partie du droit administratif).
Imaginez-vous, nous connaissons 97 % du droit mondial !
Pour la petite leçon, le système de droit mondial peut être divisé en quatre parties : le droit civil, la Common Law, le droit coutumier et le droit religieux. Aussi étonnant que cela puisse paraître, seuls deux pays sont de droit coutumier, la Mongolie et le Sri Lanka.
Plus étonnant encore, seuls sept pays sont de droit religieux, dont six musulmans : l’Arabie Saoudite, l’Iran, le Soudan, la Syrie, la Lybie et le Maroc et un seul de droit talmudique (Israël).
C’est ainsi que tous les autres états, d’où le nombre 97, appliquent soit le droit civil, soit la Common Law ou parfois les deux (droit mixte, comme au Québec).
Pour une personne comme moi, qui travaille beaucoup à l’international et par conséquent sur plusieurs juridictions, ma formation bi-juridique du Québec est sans contredit un de mes atouts majeurs.
Mon premier réflexe est toujours de me demander dans quelle juridiction je me trouve, pour ainsi déterminer les principes fondamentaux de droit qui s’appliquent.
Je parle ici des principes de base que nous apprenons tous en première année de faculté de droit; comme par exemple : les précédents judiciaires ont-ils force de loi ? Ou encore, est-ce que le principe d’équité s’applique ou pas ? Pour avoir un minimum de rigueur intellectuelle, et avant de partir dans de grandes réflexions juridiques savantes, il m’apparaît important de déterminer le système de droit applicable, sinon tout le raisonnement qui suit est tout à fait bancal.
J’adore travailler avec de jeunes gens, fraîchement sortis de l’université et de l’école du Barreau. J’aime le regard différent qu’ils portent sur notre droit, leurs idées avant-gardistes et surtout, j’ai la conviction qu’ils sont bien plus au fait des derniers développements en matière de droit qu’une vieille avocate sortie de la promotion 1990.
Confusion à profusion!
Je constate néanmoins qu’ils sont bien souvent très confus quant à l’application, au quotidien, de ces deux systèmes de droit. Il arrive souvent que des contrats de droit civil soient allégrement analysés avec des principes de Common Law et vice versa.
Je me pose alors une question : est-ce que les universités qui offrent le programme double en Common Law et en droit civil, rendent vraiment service à ces étudiants ou ne font-elles que les mêler encore un peu plus ? Par exemple, McGill, université québécoise, ne devrait-elle pas, dans son programme de Baccalauréat en droit, se concentrer sur le droit applicable au Québec (dont certains champs sont de juridiction fédérale, donc de Common Law) et offrir uniquement son programme de Common Law pour les contrats qu’en deuxième cycle d’un programme de droit, après quelques années passées sur le marché du travail? Cela donnerait ainsi aux étudiants le temps de bien assimiler ces deux systèmes si différents et leur application au Québéc.
Mais soyons francs, ce n’est pas ce qui m’exaspère le plus! Les étudiants ou les jeunes avocats ne sont pas les seuls à être mêlés dans cette histoire… Certains avocats et autres juristes très très chevronnés semblent aussi confus.
C’est important, car si nous, juristes, passons à côté de cette question fondamentale, que dire de nos pauvres clients qui n’y comprendront quedal.
Voici un exemple récent pris au hasard : la Cour Suprême du Canada vient de rendre un jugement très important mais aussi très controversé, sur les appels d’offres.
Ce jugement a pris naissance en Alberta reconnue pour être une province de Common Law. Et que titrent certains journaux québécois que je ne nommerai pas? « La Cour Suprême change les règles d’appels d’offres au Canada ». Même réaction sur le site de certains cabinets d’avocats. Quid du Québec ?
Attention, nous sommes de juridiction civiliste en matière contractuelle. Je ne dis pas qu’il faille ignorer ce jugement, mais au moins, posons-nous une question toute bête et pourtant fondamentale avant de nous lancer dans une analyse approfondie.
Questionnons-nous d’abord sur l’applicabilité de ce jugement chez nous. Certains cabinets prestigieux ont envoyé plusieurs info-lettres à leurs clients avec le texte suivant : « suite au jugement de la Cour Suprême du Canada, faites attention à ceci et cela » et ce, sans que la moindre nuance sur la portée de ce jugement au Québec ne soit même évoquée (heureusement pas tous). Navrant.
Un peu plus de rigueur
Par ailleurs, je suis encore plus désolée de constater le même manque de rigueur juridique surtout au niveau des causes affectant la vie de madame-monsieur-tout-le-monde.
Ainsi, la question du système du droit applicable en matière de droit familial, de contrats ou de droit du voyage, semble souvent être totalement sacrifiée. Certains juristes dans leur argumentation passent allégrement d’un système à un autre, afin d’obtenir une décision « juste » ou pour couper la « poire en deux ».
Ou encore, combien de fois les limites de la responsabilité des compagnies aériennes, comme prévues dans la Convention de Varsovie (ratifiée par le Canada et intégrée dans les lois du Québec selon les normes), ont été proposées d’être écartées par certains de nos éminents juristes pour des raisons d’équité?
Mais je crains d’entrer dans une autre polémique. Que les juristes qui se rappellent quand et comment une convention internationale s’applique au Québec, lèvent la main?
Mais revenons à notre système de droit. Notre Code civil a déjà adopté au début des années 1990, des principes de Common Law, se différenciant ainsi du Code civil français à bien des égards et se rapprochant de plus en plus des principes d’UNIDROIT (une certaine lex mercatoria).
Mais attention, les juristes ne sont pas le législateur. Dans notre démocratie, c’est à ce dernier que revient l’entière responsabilité de changer notre système de droit et de le rendre plus équitable, si nécessaire. Les juristes devraient se contenter d’expliquer et pour les magistrats d’appliquer le droit au Québec en matière civile. Pas le transformer. Si les intentions sont certes bonnes, ce n’est pas de l’essence même de notre système de droit.
Entre-temps, mesdames et messieurs, un peu plus de rigueur juridique. Même si nous sommes Nord-Américains, le système juridique du Québec ne se résume pas aux principes de la Common Law.
Amélia Salehabadi est la fondatrice et l'Associée principale de Salehabadi, Cabinet d'avocats, de Montréal.


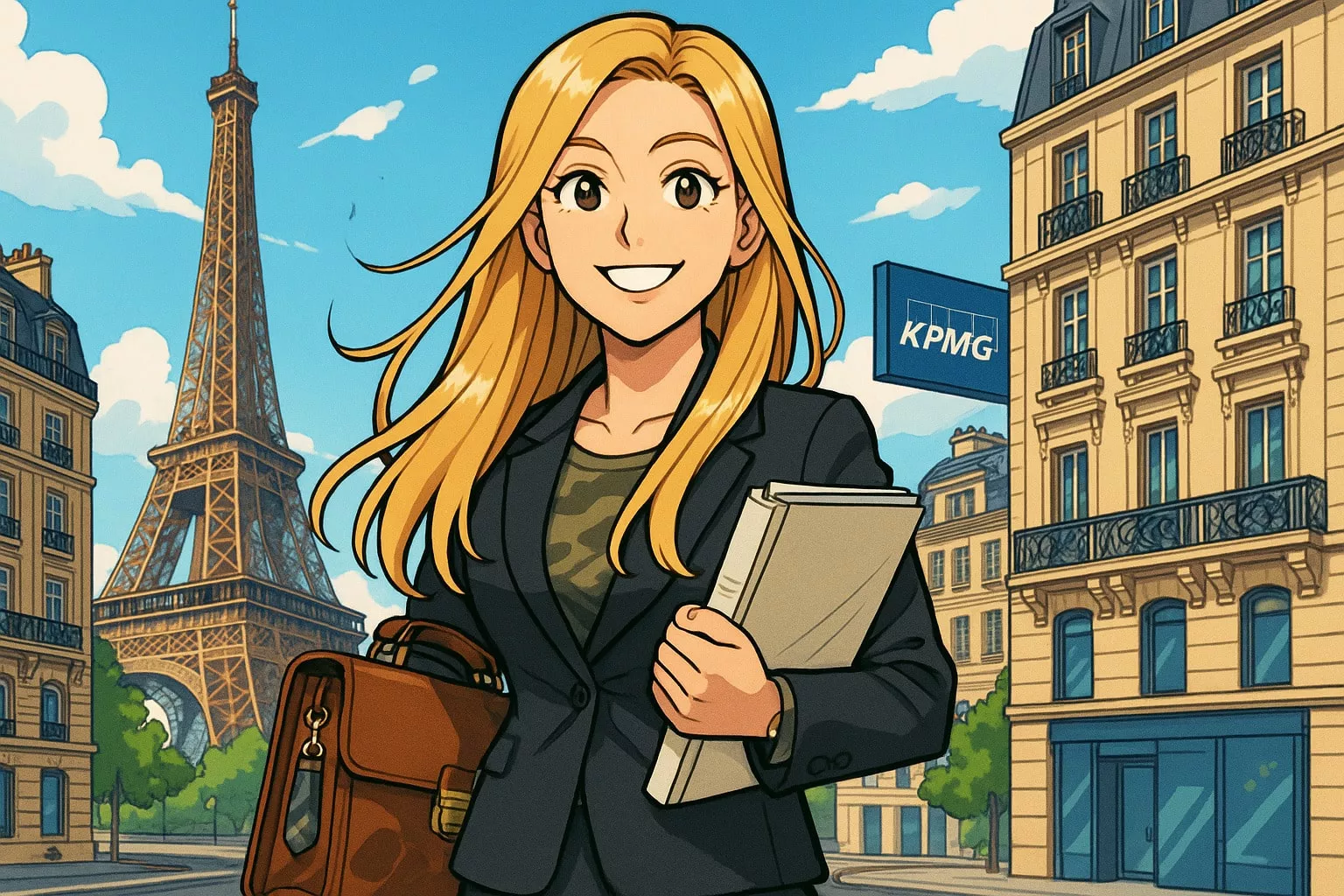








Anonyme
il y a 17 ansJe suis un peu surpris de lire ici qu'Israël serait un pays de droit "talmudique".
C'est un pays avec un système juridique complèxe, certes, donc je peux comprendre que cela porte à confusion. Il s'agit d'un système mixte, dont la majorité de la loi provient du common law et droit civil. Il reste un brin des systèmes ottoman et musulman, et certains aspects de la loi du statut personnel, dont les mariages, sont cedés aux communautés religieuses (juive, musulmane, drouze).
Mais partir de là pour en arriver à un système de droit dit "talmudique" ... tâche assez compliquée!
Anonyme
il y a 17 ans> Je suis un peu surpris de lire ici qu'Israël serait un pays de droit "talmudique".
>
> C'est un pays avec un système juridique complèxe, certes, donc je peux comprendre que cela porte à confusion. Il s'agit d'un système mixte, dont la majorité de la loi provient du common law et droit civil. Il reste un brin des systèmes ottoman et musulman, et certains aspects de la loi du statut personnel, dont les mariages, sont cedés aux communautés religieuses (juive, musulmane, drouze).
>
> Mais partir de là pour en arriver à un système de droit dit "talmudique" ... tâche assez compliquée!
Anonyme
il y a 17 ansPar Amélia Salehabadi
Tout d'abord un grand merci d'avoir pris la peine 1) de lire ma chronique et 2)de me faire des commentaires.
Je commencerai ma réponse par une petite remarque perso: ma petite chronique n'a pas la prétention d'être une dissertation savante sur le classement des grands systèmes de droits mondiaux. Il existe des thèses de doctorats et post-doctorats qui traitent de ce sujet fascinant et combien complexe. Des professeurs de droits, des juristes émerites, des sociologues du droit se penchent depuis bien longtemps sur ce sujet. Alors, le but de la chronique? provoquer un débat sur la rigueur ou pas de certains de nos juristes au Quebec quand ils jonglent avec les deux grands sytèmes de droit ayant cour dans la Belle Province.
Mais puisque vous soulevez la question du droit Talmudique, je me permettrai d'élaborer un peu plus mes propos:
Le classement des grands systèmes de droit mondiaux comporte plusieures écoles de pensées surtout en ce qui concerne les droits mixtes. Comme vous le savez, il existe plusieurs combinaison de droit mixte: par exemple le droit civil et le droit coutumier (Chine), la common law, le droit religieux et le droit coutumier (Inde), etc. La question demeure la suivante: quand est-ce que ce droit mixte devient un système de droit en soit et quand est-ce que ce n'est simplement classé comme du droit mixte (comme au Quebec, par exemple)? Vous avez tout a fait raison quand vous dites que le droit en Israel est surtout un mixte entre le droit civil et la common law avec du droit coutumier. Mais je fais partie de ceux qui pensent que le droit en Israel du fait de l'unicité des principes dérivés de l'étude de la Talmud, dont notamment la méthode de raisonnement, méritent que l'on place ce droit dans une classe a part des autres droits mixtes.
Finalement, je vous refere au site de l'Université d'Ottawa, droit civil (www.droitcivil.uottawa.ca)qui spécifie qu'ils classent le droit d'israel non pas comme simplement du droit mixte mais dans une catégorie a part, le droit talmudique, 'en raison de la profonde originalité du droit mixte en Israel'.
Un autre texte que je recommande pour ceux qui s'interessent aux droits mixtes, c'est le texte de nos confrères Me Alain Vauclair et Me Lyne Tassé sur www.themis.umontreal.ca
AS