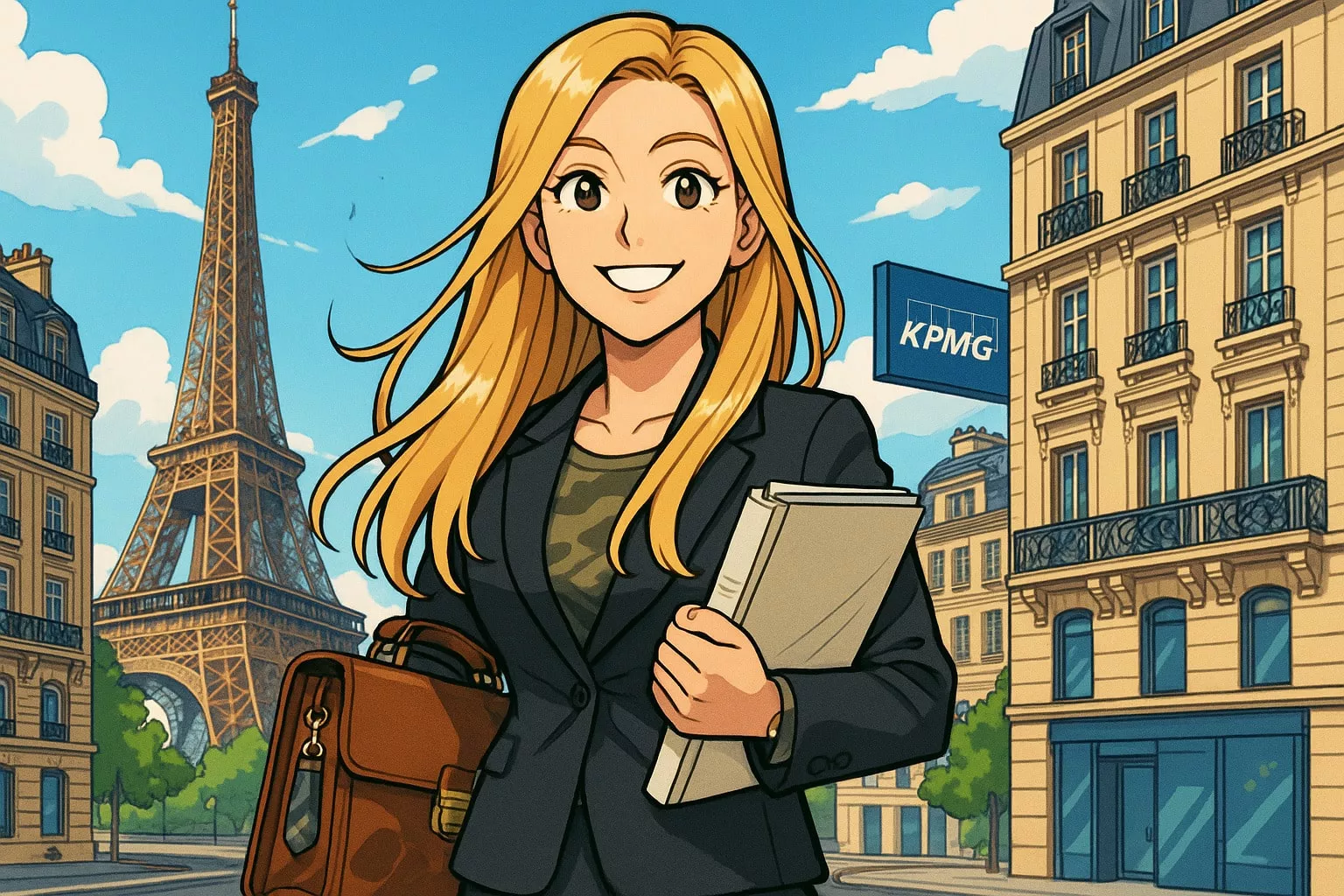Un juge accueille pour une deuxième fois une demande en rejet du recours d’une résidente en médecine

Judith Rochette Et Pierre-Olivier Tremblay-Simard
2025-02-11 11:15:42
Focus sur une récente décision de la Cour supérieure…
Le 15 novembre 2024, dans l’affaire Bouchelaghem c. Université Laval, le juge Robert Dufresne de la Cour supérieure accueillait une demande en irrecevabilité pour cause de chose jugée et en abus.

Son jugement rappelle l’importance de la présomption de validité et de la stabilité des jugements, principes liés à l’autorité de la chose jugée. Pour remettre la décision du juge Dufresne dans son contexte, il importe de rappeler la démarche de la demanderesse qui a mené à un premier jugement du juge Bernard Tremblay, j.c.s., qui accueillait une première demande en irrecevabilité.
Le premier recours
La demanderesse était candidate à la résidence en tant que doctorante hors Canada et États-Unis. En juillet 2019, elle débute son programme de résidence en médecine de famille. Le 24 novembre 2020, le Comité de promotion du programme de la faculté de médecine prend la décision d’exclure la demanderesse du programme en raison des résultats qu’elle a obtenus lors des stages réalisés à cette date.
Le 2 décembre 2020, la demanderesse porte cette décision d’exclusion en appel devant le Comité d’appel de la Faculté de médecine. Le 4 février 2021, ce comité tient une audition au terme de laquelle la décision d’exclusion du Comité de promotion est maintenue. Le 8 février 2021, le doyen de la faculté de médecine communique la décision du Comité d’appel à la demanderesse. Le même jour, la demanderesse communique avec le doyen afin de se plaindre de la décision rendue par le Comité d’appel. Le 18 février 2021, le doyen réitère à la demanderesse le contenu de la décision du Comité d’appel et l’informe que la décision de ce comité est finale. Tous ses recours internes sont donc épuisés.
Le 17 mai 2022, la demanderesse introduit contre l’Université Laval une demande en annulation de la décision finale rendue le 8 février 2021 par le Comité d’appel, intitulée Demande introductive d’instance associée [à un] pourvoi en contrôle judiciaire. Dans cette procédure de 442 paragraphes, elle cherche à obtenir sa réintégration dans le programme de résidence en médecine familiale, ainsi que des dommages et intérêts.
Alors que la contestation d’une décision d’exclusion doit se faire dans un délai raisonnable, que la jurisprudence assimile normalement à une période de 30 jours, la demanderesse entreprend son recours près de 15 mois après son exclusion du programme de résidence. L’Université dépose donc, le 28 septembre 2022, une Demande en irrecevabilité de son recours, au motif que le délai pour l’entreprendre est déraisonnable et que la demanderesse n’allègue dans sa procédure aucunes circonstances exceptionnelles valables afin de justifier son retard.
Le 15 mai 2023, le juge Bernard Tremblay, j.c.s., conclut que le recours de la demanderesse se qualifie bien de pourvoi en contrôle judiciaire et qu’il a été intenté tardivement. Pour ces motifs, il déclare irrecevable le recours et le rejette dans son intégralité puisqu’il considère au surplus que les dommages et intérêts réclamés par la demanderesse découlent directement de son exclusion du programme de résidence.
Insatisfaite de la décision du juge Tremblay, la demanderesse signifie à l’Université une Demande de permission d’en appeler d’un jugement mettant fin à l’instance. Le 19 septembre 2023, la juge Suzanne Gagné, j.c.a, rejette la demande de permission d’en appeler de la demanderesse, confirmant ainsi le caractère définitif de la décision initiale et conférant l’autorité de la chose jugée à la décision du juge Tremblay.
Le second recours
Le 30 janvier 2024, la demanderesse entreprend un nouveau recours contre l’Université Laval, intitulé cette fois Demande introductive d’instance en dommages et intérêts, par lequel elle réclame de l’Université un montant total de près de 9,5 millions de dollars. Cette procédure de 213 paragraphes reprend en grande partie les allégations du premiers recours, reprochant généralement les mêmes fautes aux mêmes intervenants.
La demanderesse élimine toutefois de sa procédure toutes les allégations liées au pourvoi en contrôle judiciaire et la justification du délai pour poursuivre, choisissant plutôt de regrouper ses reproches à l’égard de chaque représentant ou membre de l’Université.
L’Université présente une Demande en irrecevabilité pour cause de chose jugée et en rejet pour abus à l’encontre de ce nouveau recours, considérant que la demanderesse tente de faire revivre un litige déjà tranché par les tribunaux québécois, et qu’elle s’est déjà prévalue de son droit d’appel.
En réaction à la demande en rejet de l’Université, la demanderesse modifie sa demande introductive d’instance, afin d’y ajouter treize (13) défendeurs et défenderesses, à savoir, les intervenants visés par ses allégations. L’audition sur la Demande en irrecevabilité pour cause de chose jugée et en rejet pour abus des défendeurs a lieu les 9 octobre et 7 novembre 2024, devant le juge Robert Dufresne.
Le droit
Le principe de l’autorité de la chose jugée est codifié à l’article 2848 du Code civil du Québec. Afin de pouvoir établir la présomption légale de validité des jugements (chose jugée), deux conditions doivent être remplies :
L’existence de la triple identité (identité de parties, identité de cause et identité d’objet) doit être établie. Elle vise à s’assurer que la même question, concernant les mêmes parties et recherchant les mêmes conclusions en droit, a déjà été tranchée.
Le jugement doit être rendu en matière contentieuse par un tribunal compétent et il doit être définitif.
Avant de débuter son analyse de la triple identité, le juge Dufresne examine d’abord ce deuxième critère. Il constate que le jugement est rendu en matière contentieuse par un tribunal compétent puisque le juge Tremblay est saisi de la demande en irrecevabilité. Il conclut également que le jugement a acquis un caractère définitif puisque plus de trente jours se sont écoulés depuis son prononcé et que la permission d’en appeler fut refusée. Le second critère est donc satisfait.
Le juge Dufresne procède ensuite à l’analyse du critère de la triple identité. Il considère que l'identité juridique des parties entre les deux recours a bien été établie. Des centaines d’allégations sont comparées entre le premier et le second recours, de même que des dizaines de pièces produites au soutien des deux procédures. Il constate par ailleurs que la demanderesse formule les mêmes reproches dans les deux recours, bien que la façon de décrire celles et ceux à qui ils s’adressent soit quelque peu différente. Il s’exprime ainsi :
«[24] Les fautes, manquements et reproches soulevés devant le juge Tremblay, j.c.s., à l’encontre des défendeurs sont les mêmes que ceux soulevés en l’espèce. Les responsables y sont identifiés. Qu’ils soient identifiés comme responsables, préposés ou fonctionnaires, ne change pas le constat que, juridiquement, la partie défenderesse est la même dans les deux recours.»
Comme cela est reconnu en jurisprudence, le fait d’ajouter des défendeurs à un recours n’empêche pas le tribunal de conclure à l’identité de parties, puisque cette identité n’a pas à être parfaite.
Quant à l'identité de cause, le juge Dufresne remarque que même si le vocabulaire est parfois différent, les reproches de mauvaise foi, de falsification de documents, d’application illicite et illégale des normes, de violation de certains droits fondamentaux et de discrimination se retrouvent répétés ou renouvelés d’une procédure à l’autre. Dans le cadre des deux recours, la demanderesse soulève les mêmes questions en litige (ce qu’elle confirme lorsqu’elle est interrogée par le juge à ce sujet lors de sa plaidoirie).
Le second recours vise encore la compensation pour le préjudice résultant de l’exclusion de la demanderesse de son programme de résidence. Or, le juge Tremblay a déjà tranché que les dommages subis par la demanderesse découlent de son exclusion du programme. Il a déjà conclu, dans son jugement du 15 mai 2023, que c’est l’ensemble du recours qui est visé par l’irrecevabilité.
Enfin, pour ce qui est de l'identité d'objet, le juge Dufresne se demande si le nouveau recours expose le tribunal à contredire une décision antérieure. Il constate rapidement que c’est bien le cas. En effet, accueillir le recours de la demanderesse nécessiterait de rejeter les conclusions du jugement précédent.
Le caractère abusif du recours
Le juge Dufresne se pose ensuite la question de savoir si le recours intenté par la demanderesse est abusif. Il considère que c’est bien le cas, puisque la demanderesse répète les allégations d’un recours ayant déjà été rejeté. Il conclut qu’elle n'a pas agi de bonne foi et qu’elle tente de nuire aux personnes qu’elle tient pour responsables de son exclusion :
«[41]Ces modifications par ajout de défendeurs et hausse du montant réclamé constituent une utilisation de la procédure excessive et déraisonnable. Cela ne sert qu’à nuire à ces personnes que la demanderesse tient pour fautivement responsables de son expulsion du Programme. Il s’agit-là d’un détournement des fins de la justice par lequel la demanderesse tente de se faire justice à elle-même en faisant payer à ces personnes le prix de leurs fautes. Par ailleurs, la demanderesse paraît remplir de nombreux critères pour être déclarée quérulente.»
En terminant, le juge Dufresne rappelle que l’article 51 C.p.c. permet au Tribunal d’agir, même d’office, lorsqu’une partie adopte un comportement vexatoire ou quérulent. Il considère que la demanderesse satisfait plusieurs critères qui permettraient de la déclarer quérulente. Il mentionne avoir examiné ces critères et avoir envisagé de ce faire, mais considérant le fait que la demanderesse n’a pas eu l’occasion de présenter ses arguments sur la question de la quérulence à l’audience, il conclut qu’il ne peut agir en violation de la règle audi alteram partem. Il accueille la Demande en irrecevabilité pour cause de chose jugée et pour abus de l’Université et rejette l’ensemble du recours de la demanderesse.
Conclusion
Le principe de l’autorité de la chose jugée, codifié à l’article 2848 du Code civil du Québec, est l’un des piliers de notre système juridique. Lorsqu’un tribunal a rendu une décision finale, ce jugement ne saurait être remis en cause à nouveau.
Dans l’affaire Bouchelaghem, le juge Dufresne a dû examiner de nombreuses allégations et pièces, et il en vient à la conclusion que malgré une formulation différente des allégations et l’ajout des intervenants à titre de défendeurs, la nature du second recours de la demanderesse demeure en pratique identique au premier.
Ce jugement rappelle que l’utilisation de la procédure de manière excessive et déraisonnable, dans le but de nuire à la partie adverse, peut mener une partie à une déclaration de quérulence et au paiement de frais supplémentaires, ce, à l’initiative du juge saisi de l’affaire, même sans demande en ce sens par la partie faisant l’objet des reproches. La demanderesse a demandé la permission d’en appeler du jugement du juge Dufresne. Nous verrons ce qu’il adviendra de cette demande…
À propos des auteurs
Judith Rochette est associée au sein du groupe Litige et règlement des différends chez Lavery. Elle exerce sa profession principalement dans le domaine de la responsabilité professionnelle et de l’assurance.
Me Pierre-Olivier Tremblay-Simard s’est joint en 2021 au groupe Litige et règlement des différends chez Lavery après y avoir complété son stage du Barreau et œuvre principalement en litige commercial, notamment en matière de conflits entre les actionnaires, en responsabilité civile et professionnelle ainsi qu’en assurance vie et invalidité.