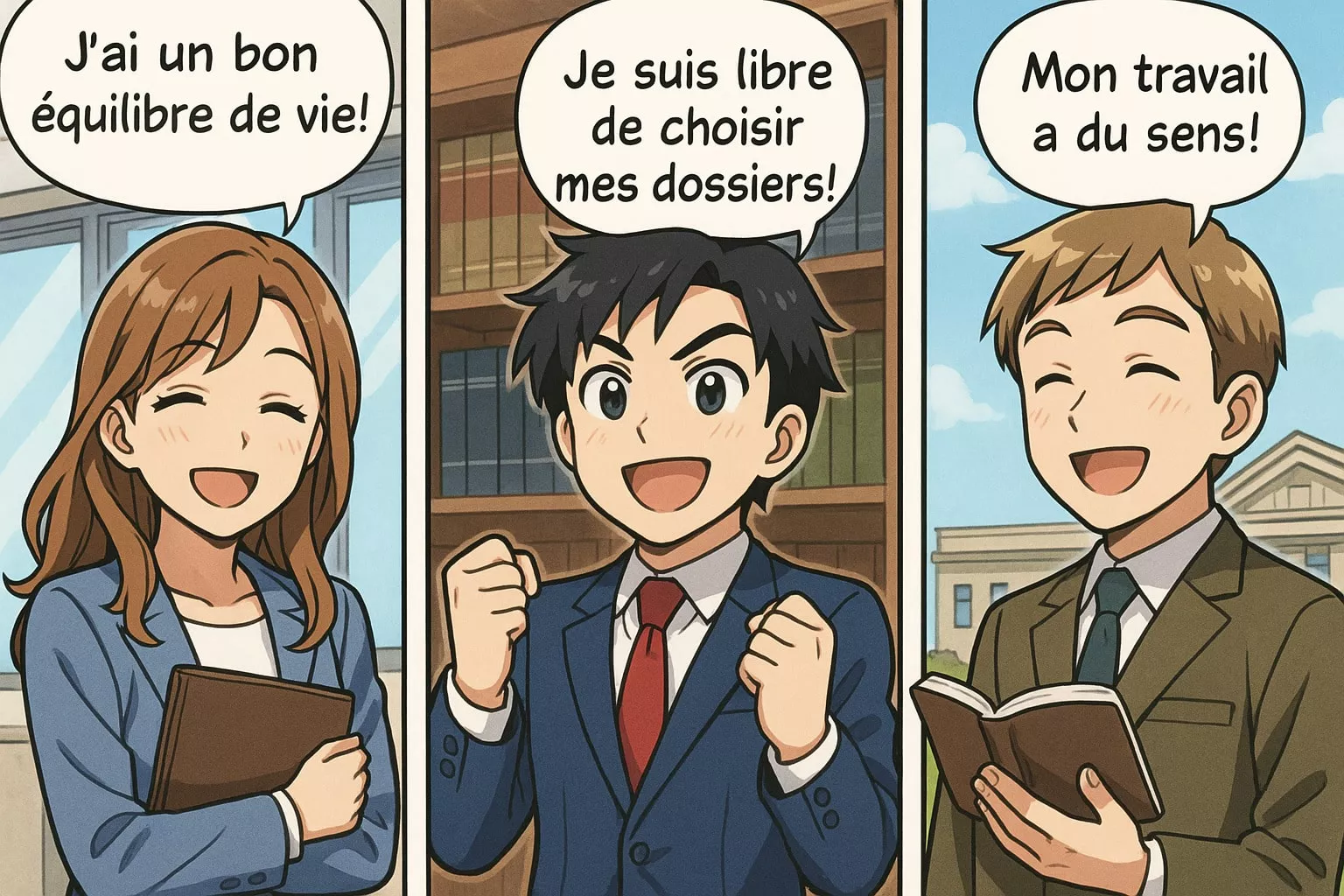La justice par téléphone en santé mentale : progrès ou pente glissante?

Emmanuelle Bernheim Et Pierre Pariseau-Legault
2020-04-06 14:15:00

La lente reconnaissance des droits judiciaires en santé mentale
Dans les années 1970, le gouvernement du Québec s’était montré avant-gardiste en tentant de confier aux tribunaux le soin de déterminer si une personne devait être maintenue contre sa volonté en établissement de santé. Malgré tout, les décisions d’internement et de soins forcés étaient prises sans audience judiciaire par des fonctionnaires n’ayant jamais vu ou entendu les personnes concernées. Ces pratiques ont eu cours jusque dans les années 1990, malgré les mobilisations et revendications politiques de groupes dénonçant des abus de droit répétés et l’absence d’une offre de services adéquate en santé mentale.
Avec la révision du Code civil du Québec et l’adoption de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental représente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, les procédures pour garder et soigner contre le gré font désormais l’objet de deux procédures judiciaires distinctes. Les décisions de garde en établissement ne peuvent être prises que par un juge, et ce, après avoir entendu la personne visée. Pour Jean Rochon, ministre de la Santé et des Services sociaux de l’époque, en confiant aux tribunaux le mandat de vérifier que la preuve du danger pour soi ou autrui en raison de l’état mental a bien été faite, cette nouvelle procédure assure que « les patients ne dépendront plus de la décision des médecins ». Il faut dire qu’à l’exception de la mise en quarantaine, la garde en établissement est le seul mécanisme civil permettant de telles restrictions au droit à la liberté.
Une justice en crise

Les personnes visées par des demandes de garde en établissement expriment bien souvent leur incompréhension des procédures, croient qu’elles sont accusées, qu’on leur reproche quelque chose. Le processus judiciaire est opaque et anxiogène pour qui n’est pas rompu au langage et au formalisme judiciaire, et est souvent vécu négativement. Nous estimons qu’une justice par téléphone est susceptible d’amplifier ces difficultés et de déshumaniser davantage une procédure qui, rappelons-le, est mise en œuvre afin d’imposer aux personnes une hospitalisation qu’elles refusent.
Appel à la prudence
Bien que des efforts aient été faits dans les dernières années afin d’assurer l’accès à des services juridiques, l’absence d’investissement pour assurer l’allocation des ressources judiciaires nécessaires, la dispense systématique d’information juridique adéquate et l’accompagnement des personnes tout au long des procédures en amènent beaucoup à dénoncer une justice à deux vitesses que ne pourraient qu’aggraver des mesures de « modernisation » qui ressemblent davantage à un retour quarante ans en arrière qu’à une innovation.
Les réformes en faveur des droits en santé mentale sont le fruit de longues luttes et sont souvent fragiles. C’est du moins ce que démontre l’histoire des dernières réformes en matière civile et criminelle. Il apparaît, dans ce contexte, essentiel que des modifications susceptibles d’avoir un effet sur la mise en œuvre des droits et sur la compréhension que peuvent avoir les personnes des procédures judiciaires qui les concernent fassent l’objet de débats où toutes les parties seraient entendues. Il ne faudrait pas que dans notre course à l’efficacité, on oublie le sens même de la procédure judiciaire, qui est de protéger les droits. Il existe un danger bien réel de généraliser des pratiques qui, bien que requises en temps de crise, ne sont justifiables ni sous l’angle des droits ni sous l’angle du respect de la dignité des personnes utilisatrices des services en santé mentale.
Sur les auteurs
Emmanuelle Bernheim est professeure au Département des sciences juridiques de l’Université du Québec à Montréal, et Pierre Pariseau-Legault est infirmier clinicien et professeur au Département des sciences infirmières de l’Université du Québec en Outaouais.