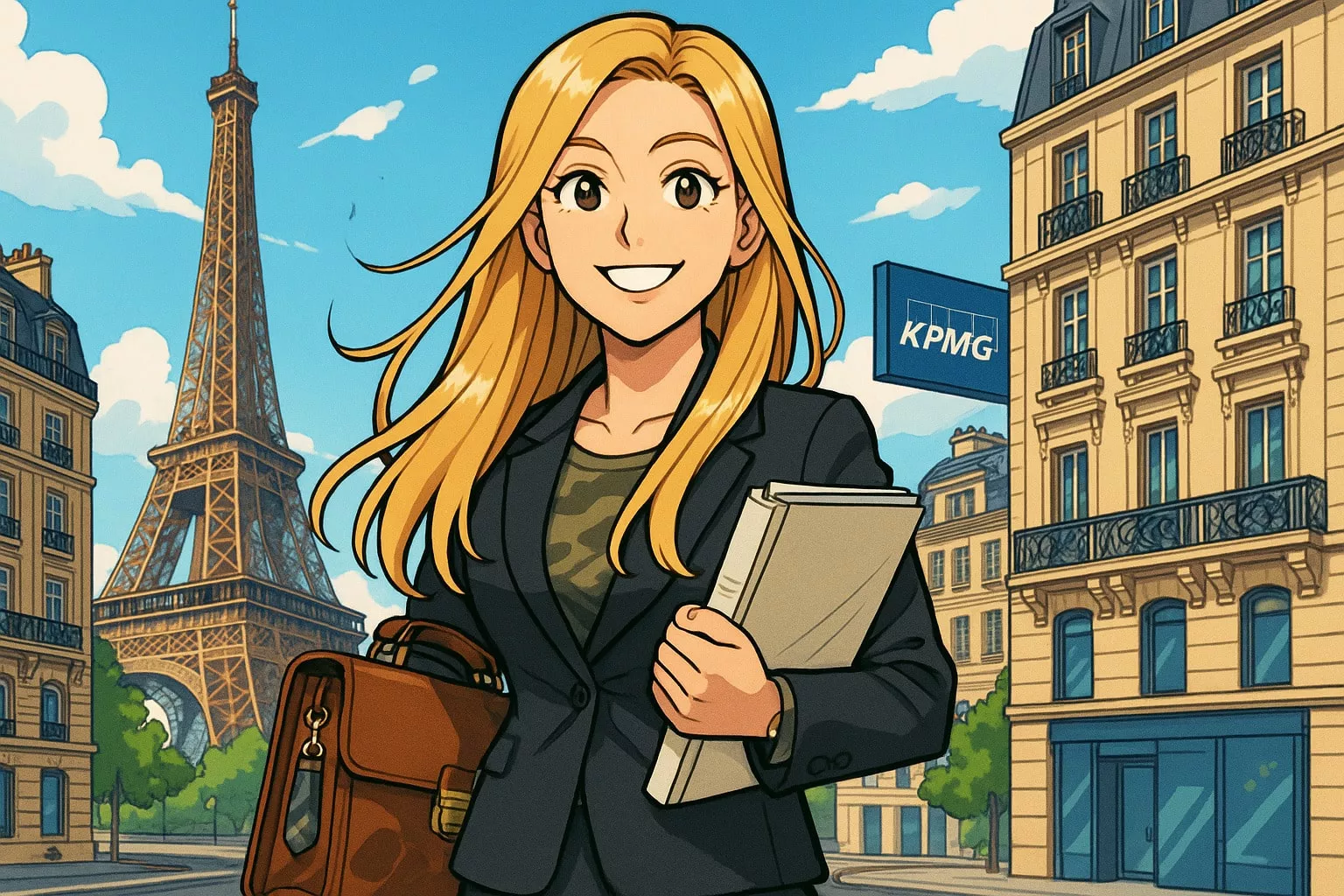Gardes en établissement : quelles nouveautés?

Céline Gobert
2018-10-30 13:00:00

Me Marie-Nancy Paquet, avocate chez Lavery et anciennement au CIUSSS de la Capitale-Nationale, et Me Sébastien Bédard, du Service des affaires juridiques de la Montérégie-Centre, en sont les conférenciers.
Cette conférence, qui vaut pour 1h30 de formation reconnue, leur permettra d’exposer les principes rappelés par la Cour d’appel dans l'arrêt JM c. Hôpital Jean-Talon, rendu en mars 2018, en matière de garde en établissement, ainsi que les conséquences de cette décision.
«Coup de semonce»
Cet arrêt, qui peut être qualifié de « coup de semonce » pour les établissements sociosanitaires québécois, se veut un rappel des principes applicables aux mesures de garde en établissement, lesquelles constituent une atteinte certaine aux droits fondamentaux des personnes concernées.
«La Cour d’Appel a choisi d’intervenir avec une décision étayée, explique Me Paquet. Cela répond à une volonté de la Cour de rappeler au tribunal de première instance et aux établissements l’importance du rôle des gardes en établissements. Cela dit: “Vous ne pouvez pas faire n’importe quoi en la matière”.
Trois thèmes y sont principalement développés : les délais applicables, la notion de consentement aux évaluations, et le sens à donner au terme « danger » ainsi que la façon dont les médecins doivent l’étayer dans leurs rapports.
Cette décision intervient d’ailleurs dans un contexte chargé sur cette question de gardes en établissements, indique Me Paquet.
D’abord, avec la diffusion par le Ministère de la Santé et des Services sociaux d’un guide d’application de la loi P-38.001 (loi sur la protection des personnes dont l’état mental présent un danger pour elles-mêmes ou pour autrui) qui sert de base législative, et ensuite avec l’encadrement que propose le projet de loi 130 (loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion des établissements de santé et de services sociaux)
Aussi, on assiste ces dernières années à un développement des contentieux à l’interne, ce qui «change les joueurs» explique Me Paquet. On voit donc plus d’avocats à l’interne des établissements, et non des avocats de cabinets mandatés sur les dossiers.
Conséquences néfastes

«Cela entraîne de plus grosses procédures pour les patients et leurs familles, qui ont deux auditions au lieu d’une, explique-t-il à Droit-inc. Parfois devant la même juge, avec les mêmes avocats. Et les avocats ont moins de temps pour préparer leurs dossiers.»
Faire la preuve de la notion de danger a en outre été rendu plus difficile aussi par la Cour qui parle maintenant de « péril important » et non plus de « danger».
Public
La présentation sera l’occasion pour les deux juristes d’analyser les conséquences de cette décision pour les avocats pratiquant en droit des personnes et pour leurs clients.
«Cette formation s’intéresse à tous les avocats intéressés de près ou de loin par les droits des personnes, et de la personne, ainsi qu’à tous ceux qui s’intéressent à la transformation du réseau de la santé», indique ainsi Me Paquet.
Les avocats en établissements sont aussi sollicités pour y prendre part, ainsi que les avocats en défense de droit des patients, conclut Me Bédard.