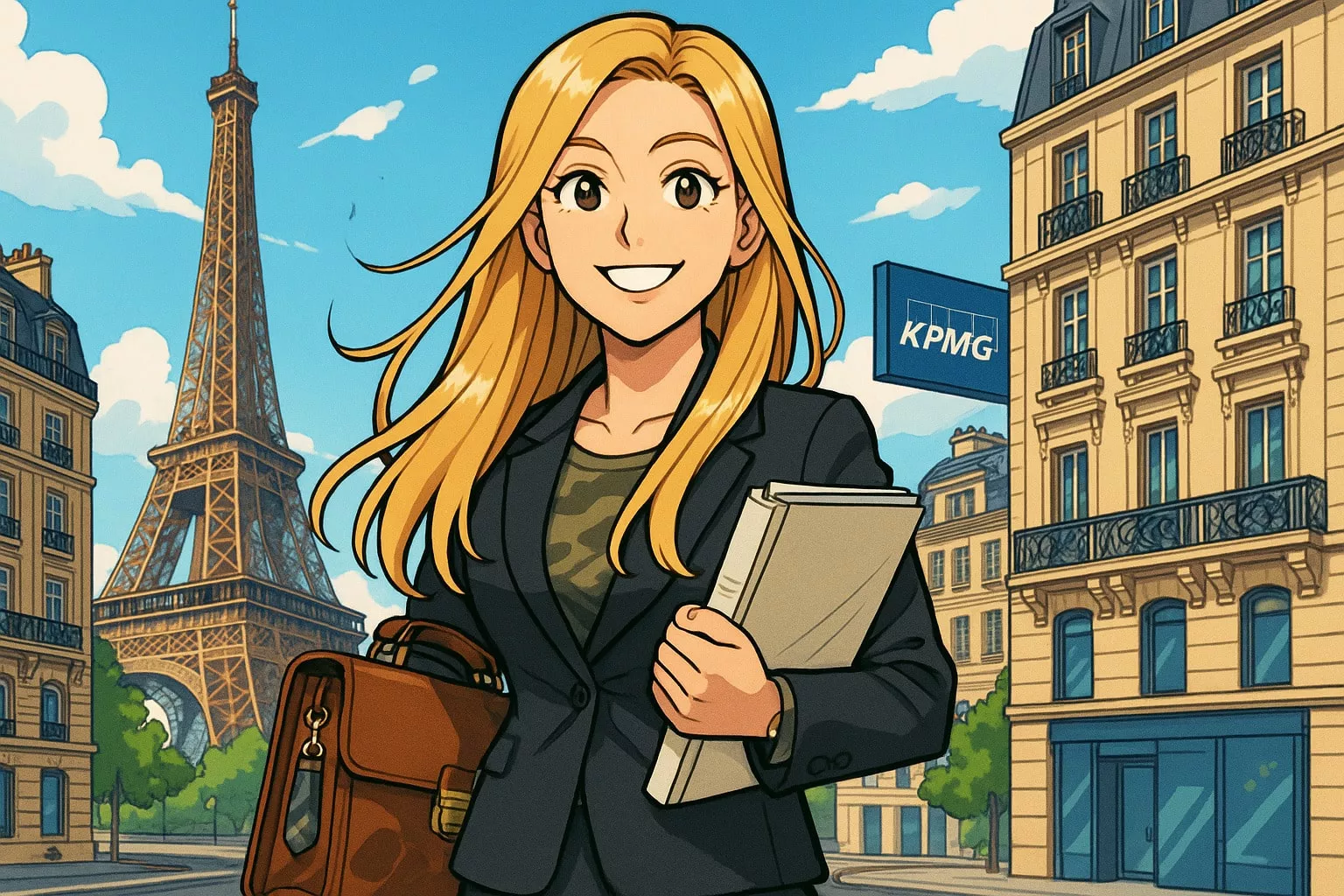Est-ce que les tarifs douaniers de Donald Trump sont légaux?

Radio-Canada Et Cbc
2025-02-04 13:15:43

La signature du décret de Donald Trump imposant des tarifs douaniers de 25 % sur les importations en provenance du Canada a eu l’effet d’un séisme partout au pays. C’est le branle-bas de combat au gouvernement fédéral. Après avoir annoncé sa riposte samedi, Ottawa a confirmé dimanche qu’il va contester la mesure américaine devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
Les experts en droit international du commerce interviewés par Radio-Canada sont sans équivoque : le décret du président américain ne tient pas la route sur le plan légal.
« C’est complètement illégal, Donald Trump n’a pas les moyens de justifier les tarifs qu’il impose », tranche l’experte en droit du commerce, Geneviève Dufour, en entrevue à l'émission Tout terrain, sur les ondes d’ICI Première.

D’abord, les États-Unis sont tenus de respecter leurs engagements de commerce international, y compris l'Accord de libre-échange Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM). Pour changer les termes de ce « contrat » et imposer des tarifs douaniers plus élevés, Donald Trump doit invoquer une exception crédible, et son excuse de protéger « la sécurité nationale » ne passe tout simplement pas le test au sens de la loi, selon Mme Dufour.
Pour justifier son intervention, Donald Trump a eu recours à l’International Emergency Economic Powers Act, une loi vieille de plusieurs décennies qui confère au président des pouvoirs économiques étendus en cas d'urgence nationale. Aux yeux du président, l’urgence nationale est « la menace majeure que représentent les immigrants illégaux et les drogues mortelles qui tuent nos citoyens, y compris le fentanyl », a-t-il écrit sur son réseau Truth Social.

« En droit américain, je crois que si on apportait ce décret [sur les tarifs douaniers] devant un juge, il serait difficile de convaincre les autorités judiciaires qu’on est devant une crise nationale », estime Richard Ouellet, professeur de droit international commercial à l’Université Laval, lors d’une émission spéciale à RDI.
« Le décret américain, en termes juridiques, ne vaut pas le papier sur lequel il est écrit », affirme Richard Ouellet.
Pour cet expert, le décret de M. Trump « va à l'encontre même du principe de base de non-discrimination en commerce international, c’est-à-dire l’interdiction de discriminer les importations en fonction du pays d’où ils viennent. Ici, on vise le Canada et le Mexique. Ça ne peut pas être plus illégal que ça ».
Aussi, le président américain ne possède pas de preuves concrètes sur la « crise nationale » qu’il dit combattre à ses frontières, et encore moins sur la responsabilité qu’il allègue aux gouvernements canadien, mexicain et chinois, selon Mme Dufour, qui est aussi titulaire de la Chaire de recherche en droit du commerce durable, responsable et inclusif à l’Université d’Ottawa.
En vue de justifier son recours à l'International Emergency Economic Powers Act, Trump a signé le jour de son assermentation l'America First Trade Policy, une note « fourre-tout » qui ordonne à plusieurs départements américains d'examiner les politiques commerciales du pays, puis d’en faire rapport au président d'ici au 1er avril, explique la professeure Dufour.
Toutefois, le président n’a pas attendu le dépôt de ces rapports avant de frapper ses partenaires commerciaux de tarifs douaniers.
En attendant, ces tarifs douaniers entreront en vigueur mardi, et c’est ce que le gouvernement de Justin Trudeau va tenter de contester devant l’OMC.
Que peut faire l’OMC?
À la demande du Canada, l’OMC va se pencher sur les tarifs douaniers de Donald Trump. La Chine a aussi fait une demande en ce sens.
Toutefois, le traitement d’un différend par cette organisation internationale qui s'occupe des règles régissant le commerce entre les pays peut prendre des mois, voire des années. L’organisation ne peut pas, non plus, accorder des dommages et intérêts, comme pourrait le faire un tribunal.

Dans un premier temps, les délégations canadienne et américaine doivent tenter de s’entendre à l’amiable, ce qui a très peu de chances de se produire, explique l’avocat spécialisé en droit du commerce international, Vincent Routhier, en entrevue à RDI. D’ailleurs, le président Trump avait statué, peu avant de signer son décret, que le Canada, le Mexique et la Chine ne pouvaient rien faire en ce moment pour échapper aux tarifs.
Faute d’une entente à l’amiable, un panel d’arbitrage sera appelé à trancher le différend en suivant non pas les lois américaines, mais bien les règles établies par l’accord de Marrakech, soit un ensemble de traités commerciaux qui a donné naissance à l’OMC, détaille Me Routhier.
« Ce que le panel va déterminer, c’est si le président outrepasse les dispositions de ses accords internationaux », explique Vincent Routhier.
Par contre, l'OMC a graduellement perdu sa capacité à juger des affaires juridiques depuis le début des années 2000, alors que Washington multiplie les plaintes à l’endroit de l’organisation qu’il juge incapable de s’attaquer aux pratiques commerciales de la Chine et bloque la nomination de juges sur l’organe d’appel de l’organisation. Ce blocage s’est d’ailleurs accentué sous le premier mandat de Donald Trump.
« Si nous gagnons [l’arbitrage], les États-Unis vont apporter l’affaire en appel, et l’organe d’appel de l’OMC ne fonctionne pas ces années-ci justement à cause des États-Unis », pointe Richard Ouellet.
Pour le professeur, cet état des lieux, d’une part, « condamne le Canada à s’entendre avec les États-Unis », et d'autre part, ne donne pas d’autre choix que de « faire mal à l’électorat américain, malheureusement ».
Même si l’OMC peut toujours compiler des rapports sur les différends, la « crise existentielle de l’OMC », comme la nomme Me Routhier, fait en sorte qu’elle perd une grande partie de son poids politique. Toutefois, l’organisme garde une certaine aura du point de vue des juristes.
Cela dit, l’OMC a le pouvoir d’autoriser les contre-mesures du Canada, qui elles aussi entrent en conflit avec ses engagements internationaux, face aux tarifs douaniers américains
« Ce fut le cas dans le cadre du différend sur le bois d'œuvre [canadien], quand les Américains n’obtempéraient pas sur la mise en œuvre des décisions de l’OMC », rappelle Me Routhier.
De plus, soulignons que le Canada pourrait aussi engager une plainte auprès de l'ACEUM, bien qu'il n'en ait pas encore fait l'annonce.
Des solutions pour dénouer l'impasse?
L’urgence de la situation justifie que le Canada contrevienne à ses ententes en matière de commerce et mette sa riposte en branle avant même de recevoir l’aval de l’OMC, pense M. Ouellet.
« Le Canada n’a pas le choix de riposter, et de riposter vite, parce que les tribunaux sont trop lents », croit-il.
Et sur le moyen et le long terme, la mission la plus importante des gouvernements fédéral et provinciaux, du point de vue de M. Ouellet, « c’est de réduire la dépendance économique à l’égard des États-Unis à l’aide d’une politique globale ».
D’ailleurs, les professeurs Richard Ouellet et Geneviève Dufour voient beaucoup de potentiel dans les autres accords de libre-échange du Canada, notamment avec 10 États de la région de l'Indo-Pacifique, avec huit États en Amérique du Sud, ou encore, avec l’Union européenne.
Étant donné l’intégration, ou l’interdépendance des marchés canadiens et américains, « nos entreprises n’ont jamais pris le risque de se diversifier », souligne Mme Dufour, qui ne jette pas le blâme sur ces dernières pour autant. Les gouvernements doivent en faire plus pour aider ces entreprises à tisser des liens avec d’autres partenaires qu’aux États-Unis, suggère-t-elle.
La spécialiste plaide aussi pour augmenter le commerce interprovincial en faisant tomber les barrières tarifaires à l’intérieur même du Canada.