Abolir les réserves, vraiment?

Sébastien Grammond Et Christiane Guay
2017-01-24 13:15:00

Il n’y a pas de doute que, durant une bonne partie de ses 150 ans d’existence, le gouvernement canadien a adopté une politique paternaliste, selon laquelle l’assimilation à la société eurocanadienne était la meilleure chose qui pouvait arriver aux Autochtones. Afin d’atteindre cet objectif, plusieurs générations d’enfants autochtones ont été envoyées dans les pensionnats. En 2015, la Commission de vérité et réconciliation a qualifié cette politique de génocide culturel. Elle a aussi montré que les pensionnats ont toujours des répercussions profondes sur les générations actuelles.
Ces politiques présentent certaines analogies avec le système d’apartheid qui a eu cours en Afrique du Sud jusqu’en 1994. Il serait cependant naïf de croire que les solutions adoptées dans ce pays puissent être transposées sans nuances à la relation que le Canada entretient avec les peuples autochtones. Abolir la différence de statut pouvait se justifier dans un cas où cette différence permettait à 10 % de la population de dominer les autres 90 %.
Cependant, au Canada, abolir les réserves équivaudrait à priver les peuples autochtones de tout ce qui leur reste de leur territoire. Ce serait éliminer la base territoriale sur laquelle ils peuvent développer leur autonomie gouvernementale. Ce serait, sous une autre forme, un retour à la politique d’assimilation tant décriée.
Différence autochtone

En réalité, les peuples autochtones cherchent à préserver leur identité et leur différence. Ils veulent contrôler leur propre destinée à l’aide de leurs propres institutions politiques. Voilà une chose que les Québécois devraient être bien placés pour comprendre. Cette idée est parfaitement formulée dans l’article 5 de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones des Nations Unies : « Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’État. »
Pour progresser vers cet idéal, il faudra réviser de nombreuses politiques gouvernementales qui contiennent toujours une dose de paternalisme. Il se peut que des pans importants de la Loi sur les Indiens soient appelés à être modernisés ou remplacés. Cependant, c’est un leurre que de croire à la disparition du statut spécifique des Autochtones et à l’abolition des réserves.
Le rapport du coroner Lefrançois contient une autre affirmation malheureuse. Selon lui, « (m)algré tout l’argent et les efforts investis au cours des dernières décennies, (...) peu de choses changent ». Le coroner ne disposait cependant d’aucune preuve à ce sujet.
Pourtant, le coroner émet une longue liste de recommandations relatives aux lacunes des services offerts aux peuples autochtones en matière de prévention du suicide. La mise en oeuvre de ces recommandations, qui sont fort pertinentes, exigera des ressources financières importantes. De plus, la plupart de ces recommandations visent la mise sur pied de services spécifiquement conçus pour les Autochtones. Elles contribuent donc à renforcer la différence autochtone plutôt que de chercher à l’effacer.
On peut contraster ces commentaires à la décision rendue par le Tribunal canadien des droits de la personne en janvier 2016. S’il y a discrimination, elle réside dans le sous-financement des services offerts aux peuples autochtones et dans le fait que ces services ne sont pas adaptés aux cultures autochtones. Réclamer la « fin de l’apartheid » n’est qu’un slogan simpliste qui ne devrait pas nous détourner des efforts considérables qu’il reste à faire pour rendre justice aux peuples autochtones.
Il a été vice-doyen à la recherche de 2005 à 2008, doyen par intérim de 2008 à 2009, puis doyen de 2009 à 2014. Dans le cadre de ces fonctions administratives, il a contribué à la mise sur pied du programme de mineure en droit et du programme de droit canadien et il a favorisé le développement d’une culture de la recherche au sein de la Section de droit civil.
Il a également participé à la mise sur pied du cours d’été portant sur les traditions juridiques autochtones dispensé dans certaines communautés cries du nord du Québec. En 2016, il a été élu membre de la Société royale du Canada.
Christiane Guay est professeure de travail social à l’Université du Québec en Outaouais.


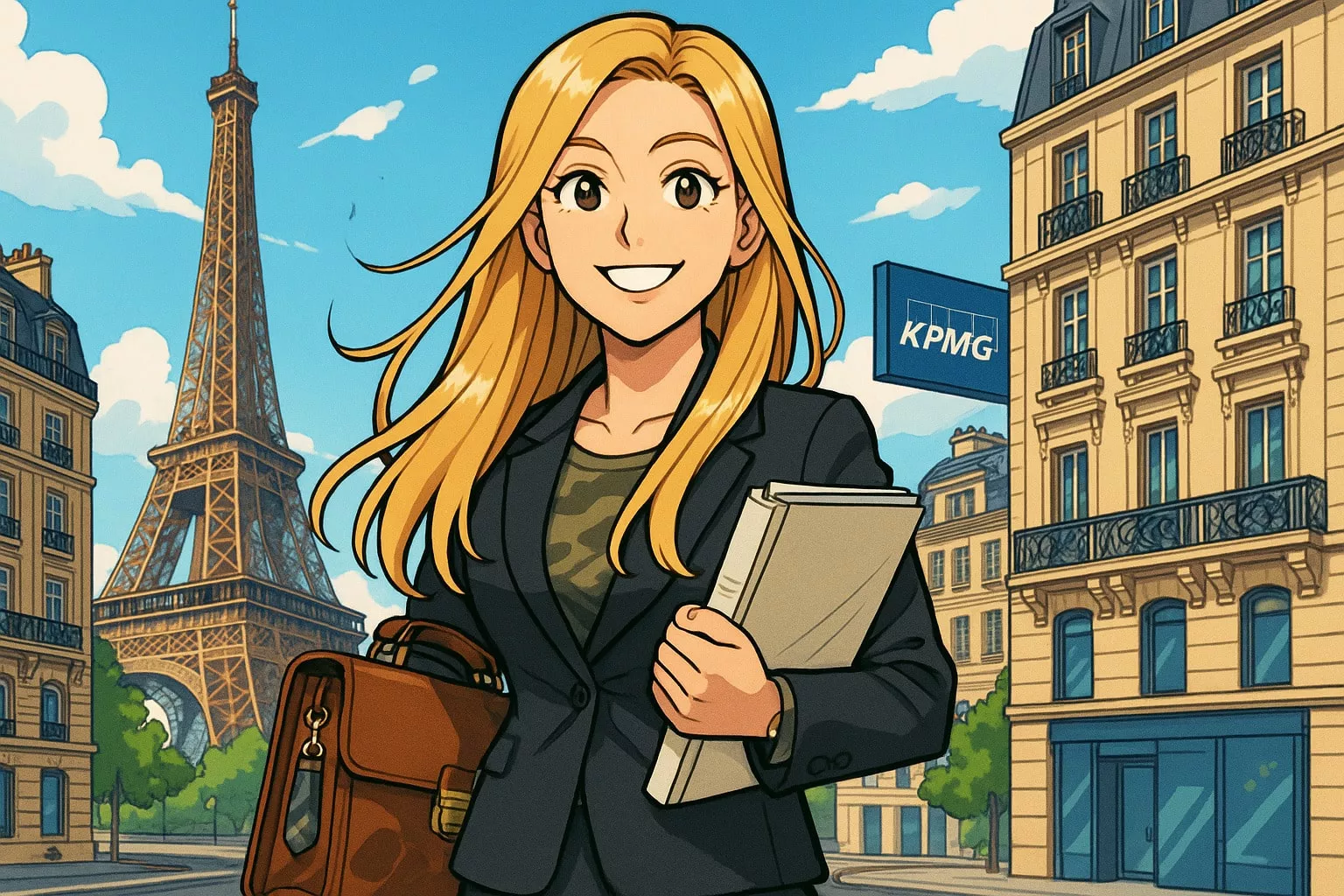








Réserves
il y a 8 ansCertains de mes clients (autochtones ou non autochtones) ont fait des tentatives de suicide.
La solution n'est pas si simple que "avec ou sans réserves".
(...)
The interventions can aim to positively influence the reasons that cause people to engage in suicidal behavior (eg, reducing hopelessness and despair within a depressive episode), but can also target other factors influencing the number and lethality of suicidal behaviors, such as reducing access to lethal methods or unfavorable media reporting inducing the Werther effect (imitation suicide).
(...).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4969705/