La loi sur les «locataires aînés», un rafistolage malavisé

Pierre Gagnon
2016-06-20 11:15:00

Mais au-delà du pétage de bretelles, que prescrit cette loi ? Elle édicte essentiellement qu’on ne peut pas expulser un locataire 1) de 70 ans et plus 2) qui habite son logement depuis plus de 10 années, et 3) qui est admissible à un logement à loyer modique. Ni moins, mais surtout ni plus… (Toute une édulcoration pour le projet de loi original, déposé en 2015 par Québec solidaire).
Selon quelle logique un vieillard en santé est-il plus vulnérable qu’une famille monoparentale pauvre? L’Assemblée nationale vient d’adopter dans l’enthousiasme une disposition clairement empreinte d’âgisme à rebours !
Peu de modifications depuis 1979
Le problème encore plus fondamental ici, c’est que ces joviales et fraternelles claques dans le dos camouflent une impuissance endémique à faire correspondre les lois du bail résidentiel à l’évolution de la société. Le cadre législatif en ce domaine a été mis en place en 1979. Depuis lors — et malgré la promulgation du nouveau Code civil de 1994 —, on relève peu de modifications substantielles, ni quant aux règles applicables en la matière ni quant au fonctionnement de la Régie du logement.
Toute comparaison est boiteuse, mais au cours de sensiblement la même période, l’Ontario a procédé à cinq refontes fondamentales de sa législation en la matière. Au-delà des différentes idéologies qui se succèdent au pouvoir, la transformation constante du tissu social impose un réexamen assidu des normes locatives et de leur application.
Près de 40 % de la population québécoise vit dans une demeure louée. De façon générale, on peut avancer que la relation locateur-locataire y est plus « tricotée serrée » qu’ailleurs. Soulignons également que des centaines de milliers de « petits propriétaires » investissent leurs économies dans le secteur locatif. La Régie du logement, qui reçoit annuellement plus de 70 000 demandes, est le tribunal civil le plus fréquenté du Québec.
Des solutions improvisées
Au cours des dernières décennies, le vieillissement de la population chambarde considérablement le domaine de l’habitation. Malgré certains progrès estimables en la matière (par exemple, la certification des résidences), les solutions adoptées par les pouvoirs publics sont trop souvent marquées au sceau de l’improvisation. La même remarque s’impose quant aux besoins d’information et d’accommodement des immigrants, lesquels constituent une part toujours croissante de la clientèle locative.
Dans son rapport annuel 2000-2001, la Régie du logement faisait déjà état de son « rôle à jouer pour l’adaptation du cadre légal des relations entre locataires et propriétaires aux réalités nouvelles » (p. 29). Puis, près d’une décennie plus tard, en novembre 2010, le ministre responsable de la Régie promettait une réforme substantielle en la matière. Cet engagement est resté sans suite, note le Protecteur du citoyen dans son rapport 2010-2011 (p. 52). Autant en emporte le vent…
Malheureusement, il nous semble assister à une partie d’« au plus fort la poche », au cours de laquelle associations de locataires et de propriétaires tirent la couverture chacun en sens opposé, espérant arracher avantages et concessions d’un gouvernement toujours sensible aux éphémères variations de l’opinion publique. Cela dit, les deux camps sont tout de même d’accord sur un grief commun : l’ampleur démesurée des délais d’audience, une anomalie carrément inacceptable dans un domaine aussi mouvant que le bail résidentiel.
Les principes fondateurs de la législation québécoise en matière de louage résidentiel sont sains : ils ont subi l’épreuve du temps. Par ailleurs, la Régie du logement est un tribunal de facture conviviale qui joue un rôle capital pour la préservation et l’amélioration du tissu social. Mais l’édifice est lourdement lézardé.
Il serait plus que temps de convoquer des états généraux auxquels participeraient toutes les catégories d’intervenants : employés de la Régie du logement, représentants d’associations, responsables gouvernementaux, etc. M’est avis qu’on serait surpris des consensus qu’une telle démarche pourrait dégager. Car le capharnaüm actuel n’avantage strictement personne.
Ce texte est initialement paru dans Le Devoir.
Il a rédigé bon nombre d'articles et de commentaires juridiques portant sur le droit résidentiel, les assurances, les relations du travail et les droits de la personne. Il est notamment l'auteur (avec Me Isabelle Jodoin) du llivre Louer un logement, 2e éd. (Éd. Yvon Blais, 2012).__


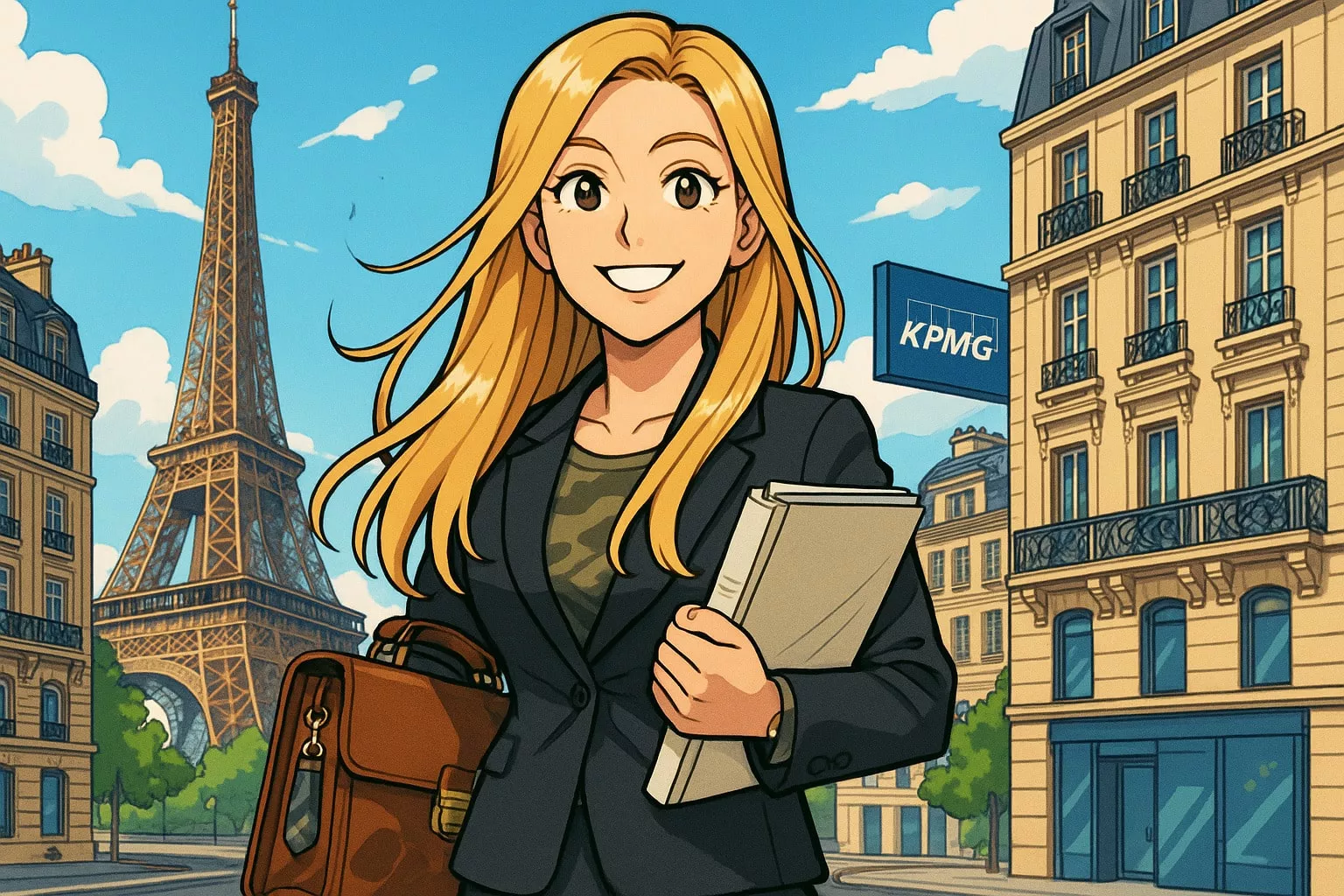









M.Deslauriers
il y a 8 ansAujourd’hui les aînés ayant peu de fond de pension bénéficient des ressources du parc immobilier des OSBL d’habitation pour se loger à un prix décent. Celui-ci s’apprêterait cependant à être démantelé. L’annonce n’est pas encore officielle mais le gouvernement mettrait fin à ses subventions et au contrôle qu’il exerce sur les gestionnaires. Pourtant les immeubles sont entièrement payés pour la plupart et représentent au Québec un patrimoine de 4.7 Milliards$ dans 400 municipalités, pour un total de 50 000 logements et une masse salariale globale de 175 million$. Sans grande protestation, plusieurs exploitants songent dès l’automne à convertir les appartements au prix du marché par attrition et déjà des bâtiments sont vendus à des promoteurs à la condition d’inclure quelques appartements subventionnés (Les immeubles Louvain). Pourquoi la Société d’habitation du Québec et la Société d’hypothèque et logement renoncent-ils à leur mission « de soutien au loyer modique » pour personnes âgées? Pourquoi se sont-ils désistés des programmes qui consistaient à combler le déficit d’exploitation qu’occasionnaient les prix locatifs modiques et à surveiller l’administration des gestionnaires? Pourquoi la SHQ et la SHL préfèrent-ils financer de nouvelles construction plutôt de conserver son patrimoine? Le Réseau québécois des OSBL d’habitation s’en inquiétait déjà en décembre 2015 et si la Loi 492 représente une mesure de mitigation pour le désordre à venir, il s’agit d’une bien pâle mesure de protection des aînés.