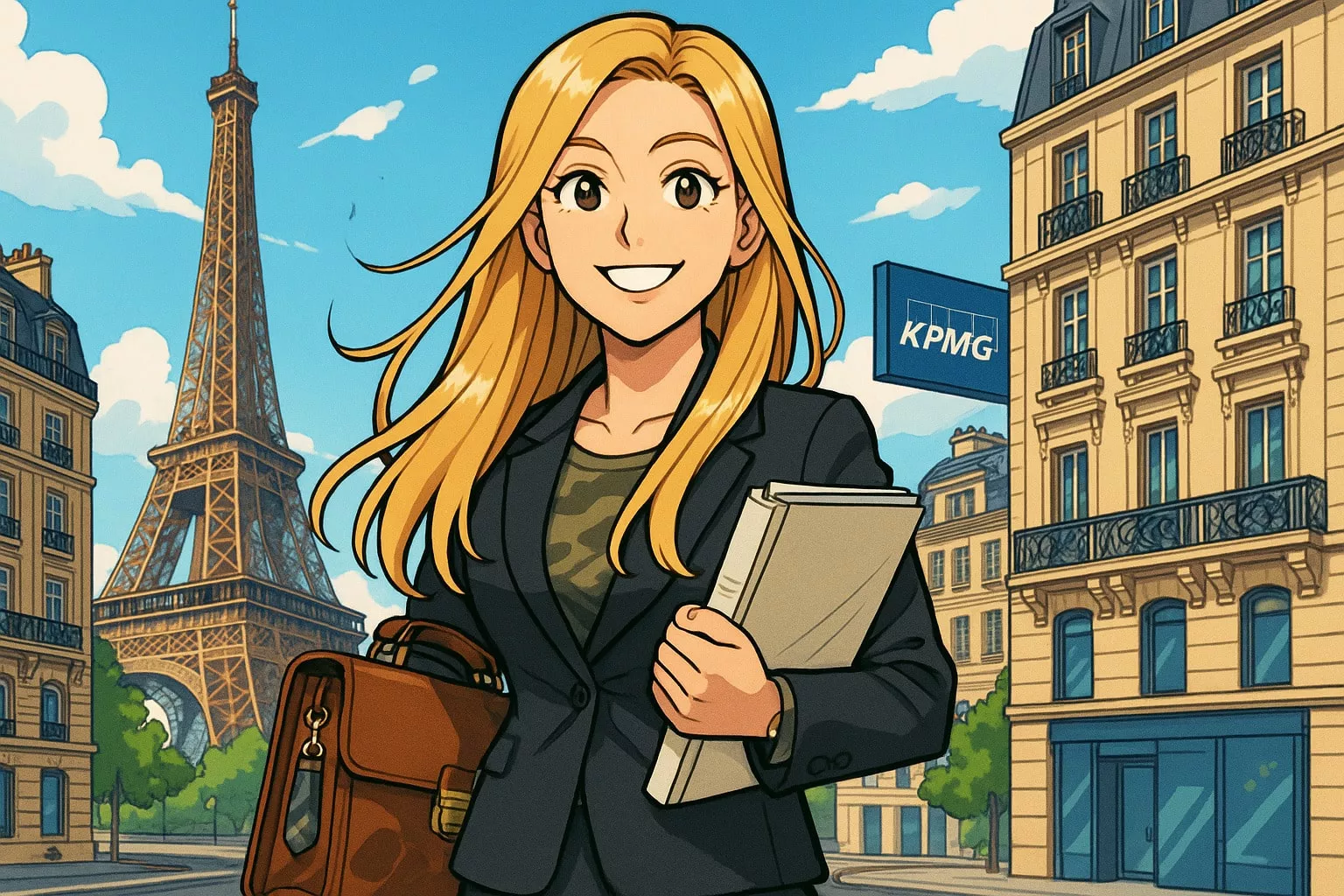Le Barreau fait-il de la politique?

Guillaume Rousseau
2014-01-23 15:00:00
Le très vénérable ordre professionnel y développe un argumentaire sans nuance contre toute interdiction générale du port de symboles religieux. Même le port de la burqua lors d’un témoignage trouve grâce à ses yeux. Son implacable syllogisme se résume comme suit: «Nous sommes pour le droit ; le droit permet le port de la burqua ; donc nous sommes pour la burqua».
Pourtant, même en s’inspirant strictement du droit, le Barreau aurait pu développer une position beaucoup plus nuancée. Et il aurait eu avantage à le faire, notamment à la lumière d’une affaire récente au cours de laquelle la Cour supérieure a sévèrement critiqué le Barreau pour avoir pris une position politique en invoquant un argument de droit mal fondé.
L’affaire De Belleval contre Québec: ou quand la Cour supérieure rabroue le Barreau pour sa position politique mal fondée en droit

Puisque la ville de Québec n’avait pas procédé par appel d’offres, certains adversaires politiques du maire Labeaume ont alors annoncé leur intention de contester ces ententes devant les tribunaux.
Pour contrer les effets de l’incertitude créée par cette annonce, le Parti Québécois déposa un projet de loi pour confirmer la validité de ces ententes. Puis, soudainement, des montréalocentristes et des Quebecorophobes, nombreux dans certains médias, se sont trouvés une vocation de spécialistes du droit municipal et du droit constitutionnel. C’était évident: les ententes étaient illégales et le projet de loi inconstitutionnel!
Avec d’autres, j’ai alors développé un argumentaire solide pour expliquer pourquoi les ententes étaient légales (la liberté contractuelle permet à la ville de procéder comme elle veut sauf lorsqu’une loi limite clairement cette liberté) et le projet de loi constitutionnel (l’Assemblée nationale peut adopter une loi rétroactive en vertu de la Souveraineté du Parlement sans qu’elle soit rendue inconstitutionnelle par la primauté du droit). En raison du brouhaha médiatique, cet argumentaire passa inaperçu, bien qu’il fut repris par des députés.
Dans ce contexte, on aurait pu s’attendre à ce que le Barreau éclaire le débat en utilisant sa crédibilité pour révéler l’état réel du droit sur la question. Il n’en fut rien, au contraire. Le Barreau canadien est allé en commission parlementaire défendre la position selon laquelle le projet de loi était contraire au principe de la primauté du droit.
Il fut alors déculotté par un député au fait de l’état réel du droit. Se croyant plus rusé, la Barreau québécois n’est pas intervenu en commission parlementaire, préférant défendre cette position devant la Cour supérieure.
Il semble toutefois que cette dernière n’ait pas apprécié. Dans son jugement, qui confirme sans l’ombre d’une hésitation la validité des ententes et de la loi, elle mentionna que, et je cite «Sous le couvert de la primauté du droit, tout comme les demandeurs, le Barreau du Québec attaque en réalité l’opportunité pour le Parlement d’adopter une loi ayant des effets rétroactifs, pour conclure à sa nullité», ce qui revient à dire qu’il a fait de la politique.
Puis, avant de reprendre les arguments évoqués au précédent paragraphe de la présente lettre ouverte, le tribunal ajouta que «la position du Barreau, formulée après l’adoption de la Loi privée, est aussi mal fondée».
Après avoir été ainsi rappelé à l’ordre, le Barreau aurait pu se montrer plus prudent pour l’avenir.
À la lumière de son mémoire sur la Charte des valeurs, force est de constater qu’il n’en est rien.
L’«affaire» Barreau du Québec contre Charte des valeurs: ou quand le manque de nuances risque de nuire à la crédibilité d’un organisme vital
Notamment dans le but de ne plus être rabroué par les tribunaux, et d’ainsi préserver intact son immense crédibilité d’organisme vital à l’État de droit, le Barreau pourrait se montrer beaucoup plus nuancé lorsqu’il prend position publiquement.
Son objectif pourrait être de présenter le droit dans toutes ses nuances. Ce n’est pas ce qu’il fait en se prononçant contre l’interdiction relative de la burqua proposée par la Charte des valeurs.
Le Barreau se rallie aux juges majoritaires de la Cour suprême qui, dans R. c. N.S., se sont prononcés contre une interdiction générale du visage couvert lors d’un témoignage.
Cependant, il ne mentionne pas que des juges du plus haut tribunal canadien, minoritaires certes mais pas nécessairement pour toujours, ont plutôt dit qu’en droit canadien une telle interdiction était légale, et ce, précisément au nom de la neutralité de l’État.
Il ne s’agit là que d’un exemple parmi d’autres, parce qu’il serait possible de prendre pratiquement chaque point du mémoire du Barreau et de le nuancer en citant un courant jurisprudentiel omis ou une décision importante qui jette un éclairage différent. Et cela va de soi, puisque le droit est presque toujours sujet à interprétation.
Il ne s’agit pas de dire que le Barreau aurait dû prendre position en faveur de la Charte des valeurs. Il s’agit de dire que dans ce genre de débat politique, il devrait proposer un éclairage nuancé plutôt qu’une position tranchée. Cela diminuerait les risques qu’il défende une position mal fondée en droit et qu’il soit perçu comme prenant une position politique partisane, avec les conséquences que cela peut avoir pour sa crédibilité.
Et il n’y aurait là rien de contradictoire avec sa mission consistant à défendre la primauté du droit, pour autant qu’il ait une conception de cette dernière qui soit conciliable avec la Souveraineté du Parlement.
Autrement dit, plutôt que de défendre une conception qui s’apparente à celle du «gouvernement des juges», il devrait défendre une position plus proche de celle du «gouvernement avec juges» qui laisse une place prépondérante aux élus lorsque vient le temps de fixer les règles du vivre-ensemble.
Ainsi, il ferait du droit, et laisserait les politiciens faire de la politique…
Me Guillaume Rousseau est professeur adjoint à la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, dans le domaine du droit municipal, droit constitutionnel, procédure civile et droit de l’aménagement et de l,urbanisme.
Il détient une maîtrise en droit comparé, avec spécialisation en droits de la personne et diversité culturelle de l'Université McGill. Il a également effectué un stage et a pratiqué comme avocat en droit municipal et en droit de l’aménagement et de l’urbanisme chez Fasken Martineau, et a également travaillé pour le Ministère de la Justice du Québec et la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick.
Il a été conseiller à l’Assemblée nationale du Québec au moment des consultations autour de l’avant-projet de loi sur le nouveau Code de procédure civile, et il a effectué des études doctorales en droit à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne et à l'Université de Sherbrooke.
Me Rousseau pratique actuellement à la clinique Juripop de l’Estrie.