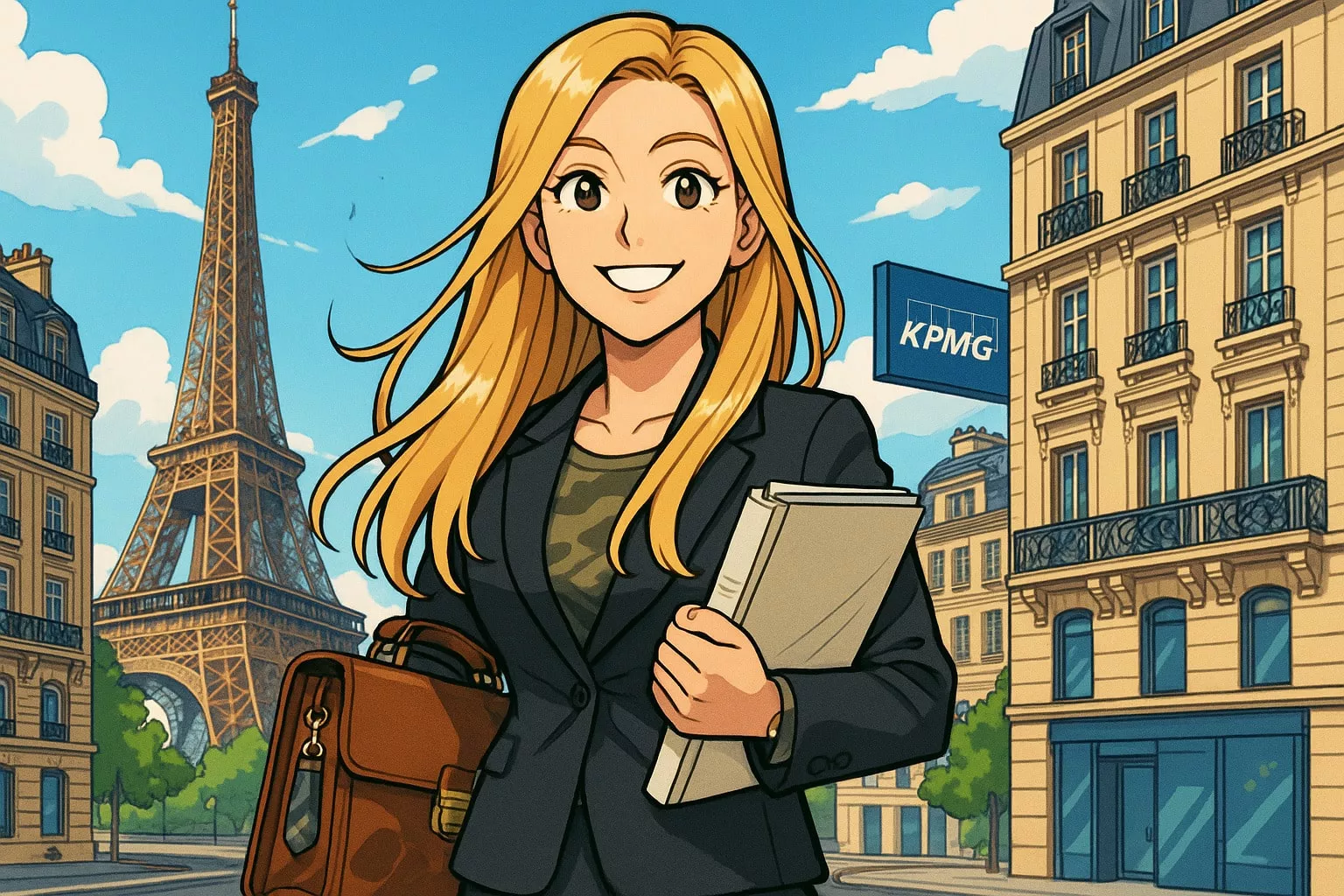Le psy, la cliente, son ex et le journal intime

Radio-Canada Et Cbc
2025-02-07 11:15:46

Ils pensaient être amoureux, ils étaient en fait hors-la-loi. Pierre Faubert et Adèle Gélinas* forment un couple depuis trois ans et demi. Jacques Létourneau* et Sophie Pilon*, eux, sont mariés depuis 2015.
Les deux hommes sont psychologues; ils ont rencontré leur conjointe dans le cadre professionnel et ont commencé à les fréquenter après la fin de la thérapie. Ni l’une ni l’autre ne croyaient mettre ainsi en jeu la carrière de leur nouveau conjoint.
Le syndic de l’Ordre des psychologues, qui veille à faire respecter la déontologie de la profession, a cependant vu les choses autrement. Pour lui, Adèle et Sophie sont des personnes vulnérables, même si elles rejettent fermement cette étiquette. À ses yeux, l’acte des deux professionnels méritait donc sanction. L’un fut forcé de mettre fin à sa carrière. L’autre a dû dépenser des centaines de milliers de dollars pour la sauver.
Cette sévérité ne vient pas de nulle part. En 2017, après des années de complaisance, Québec serrait la vis. Désormais, les professionnels reconnus coupables d'inconduite sexuelle avec une cliente ou une ex-cliente perdent leur droit de pratique pour un minimum de cinq ans. Une sanction stricte et quasi automatique pour corriger des années de peines trop clémentes, surtout chez les professionnels de la santé.
On souhaite ainsi mieux protéger des gens vulnérables contre des professionnels aux pratiques prédatrices. Mais que penser lorsque la seule preuve d’abus professionnel est l’existence d’une relation amoureuse? Et que dire lorsque les présumées victimes que le syndic affirme défendre l’accusent de les humilier et de les infantiliser?
Pierre et Adèle
Il y a plus de quatre ans, Adèle Gélinas*(nom fictif) a consulté un psychologue. Nous sommes en pleine pandémie, et Adèle, cadre dans une entreprise, remet son couple en question. Elle songe à quitter son mari, le père de ses deux adolescents.
« Après 25 ans de vie commune, je sentais que la flamme n’était plus là. Je n'étais plus bien, je voulais vivre ma vie autrement. Et j'avais envie d'explorer aussi, de savoir qui j'étais, plus en profondeur ».
Adèle contacte Pierre Faubert, psychologue depuis 25 ans, qui avait déjà traité un membre de son entourage.
« Il m'a dit qu'il pouvait me rencontrer. Je me suis trouvée très chanceuse, et on s'est bien entendus. J'aimais beaucoup son approche, son écoute, la façon dont il interagissait ».
« Les rencontres étaient semblables à toutes les autres rencontres que j'ai eues », se souvient Pierre Faubert, 75 ans. « Il fallait créer un climat de confiance, il y a une alliance qui se développe et, donc, une certaine intimité ».
Après trois mois de consultations, Adèle doit se rendre à l’évidence : elle commence à voir son psychologue sous un autre jour.
« J'ai réalisé, en sortant d'une séance, que j’avais des sentiments pour lui. (Mais) ce n'était pas clair pour moi : je ne voulais pas nécessairement tomber en amour, je ne voulais pas avoir de relation avec cet homme-là, du tout, c'était hors de question (...) Mais de toute façon, j’allais quitter mon mari ».
Le transfert amoureux
L’apparition de sentiments amoureux chez le patient à l’endroit de son thérapeute n’a rien d’inédit. Le terme clinique est « transfert ».
« Il n’est pas rare que ce genre de phénomène se produise lors de consultations psychologiques intenses », rappelle Louis Brunet, professeur retraité de déontologie en psychologie à l’UQAM.
« Le transfert, en psychothérapie, c'est un client qui déplace des relations problématiques ou heureuses sur la personne du thérapeute. Et lorsqu'il y a un transfert amoureux, ça prend plus d'expérience ou plus de formation de la part du thérapeute pour être capable d'y faire face avec tact et sans répondre, en tombant amoureux soi-même ».
Reste à savoir que faire quand les sentiments l’emportent.
Car c’est exactement ce qui s’est passé, même si Adèle est celle qui a déclaré son amour en premier. Dans son dossier, plus tard utilisé en preuve par le syndic, Pierre Faubert note le transfert de sa cliente et, plus tard, son contre-transfert. Il était, lui aussi, tombé amoureux.
« Ça m'a beaucoup affecté. C'est allé directement au coeur. Parce qu’Adèle était une personne très ouverte, très spontanée et... vivante. (...) Il y a quelque chose qui s’est passé, c’est sûr ».

C’est, pensent-ils, ce qu’il y a de mieux à faire. Mais c’est aussi trop peu aux yeux de la loi.
« J’aurais dû consulter moi-même un psychologue, concède maintenant Pierre Faubert. J'aurais eu besoin de consulter, mais je ne l'ai pas fait. J'admets ça, c'est un manquement de ma part ».
C’est effectivement ce que la bonne pratique recommande, rappelle le professeur Louis Brunet. « On va voir un collègue en qui on a confiance, un superviseur, et on essaie de comprendre ce qui se passe. Et là, on peut éviter de tomber dans le panneau ».
Adèle est encore ébranlée par le prix qu’ils ont dû payer.
« Je sais bien qu’on ne peut pas avoir une relation amoureuse avec son psychologue, mais je ne me doutais pas de la gravité de ce que ça pouvait entraîner ».
Le plaignant? L’ex-conjoint
Adèle a quitté son conjoint à la mi-mars 2021. Quelques semaines plus tard, Pierre lui demande de ses nouvelles par courriel; ils se revoient et vont marcher ensemble.
Après six mois de fréquentation, ils finissent par devenir un couple, à l’automne 2021.
Leur relation s’est donc concrétisée, au sens sexuel du terme, cinq ou six mois après la fin des consultations. Mais était-ce éthique pour autant? Au Québec, il n’existe pas de règle claire sur la longueur de la période d’attente. C’est donc au syndic, de facto, d’en juger.
Tout cela n’a évidemment rien d’une science exacte.
« Si j'avais une boule de cristal, j'adorerais pouvoir vous donner une réponse précise », soupire Me Chantal Perreault, avocate, ex-syndic du Barreau et spécialiste du droit disciplinaire. « Que la ligne soit claire et qu'on puisse dire : là, je suis en sécurité, et là, je suis en danger. Je n’en ai pas, malheureusement. Chaque cas doit être regardé avec son contexte particulier ».
Plusieurs critères entrent en jeu pour déterminer la durée d’une relation professionnelle : la vulnérabilité du client ou la nature de ses enjeux psychologiques, par exemple. Dans le cas d’Adèle, le syndic de l’Ordre des psychologues s’est notamment appuyé sur un expert, qui a conclu qu’elle était « très vulnérable ». Cet expert, Adèle ne l’a jamais rencontré.
Six mois après le début de sa relation de couple, Pierre Faubert apprend qu’il fait l’objet d’une plainte pour inconduite sexuelle à l’Ordre. C’est la première déposée à son endroit en 25 ans de carrière.
À ce stade-ci, la question se pose : qui a déposé la plainte si ce n’est pas sa nouvelle conjointe?
La réponse : l’ex-conjoint d’Adèle, qui, pour prouver ses dires, a remis au syndic une copie des pages du journal intime de sa femme.
« Mon ex avait volé mon journal, pris des photos, transcrit et transmis (les éléments) au syndic. Il a fait la plainte à partir des extraits volés de mon journal », dit Adèle.
À son insu, tous les secrets d’Adèle se retrouvent entre les mains de l’Ordre, prêts à servir de preuves à charge contre son nouveau conjoint.
Jacques et Sophie

Dans environ une plainte sur quatre, c’est l’ex-conjoint qui demande au syndic d’enquêter. C’est ce que nous avons découvert en étudiant les 44 décisions disciplinaires du conseil de discipline de l’Ordre des psychologues en matière d’inconduite sexuelle des dix dernières années. Au Québec, ce sont les psychologues, devant les médecins et les infirmières, qui sont le plus souvent radiés pour ce genre d’infraction.
C’est arrivé à Pierre Faubert, mais aussi à Jacques Létourneau* (nom fictif). Son ex-conjointe, dont il était séparé depuis quatre ans, contacte le syndic pour l’informer qu’il est en relation avec Sophie Pilon* (nom fictif).
Il est, de fait, marié avec elle.
Sophie n’a jamais suivi de thérapie avec Jacques Létourneau. Quatre ans auparavant, alors qu’elle venait de perdre son mari, elle a envoyé ses deux jeunes enfants le consulter; ils avaient besoin d’aide pour mieux faire face à leur deuil.
Sophie n’assiste pas aux consultations, mais c’est elle qui règle les honoraires du psychologue. Ce qui en fait, selon l’Ordre, une cliente.
Seize mois après la fin des consultations, ils se rencontrent par hasard en courant sur une piste de jogging. À cette époque, Sophie commence à rebâtir sa vie après la mort de son époux.
« On s'était revus, quand on courait. Et tranquillement, on a repris une forme de contact, en faisant très attention, parce que lui avait aussi des enfants. On y allait tranquillement, vraiment très tranquillement », raconte Sophie.
Jacques renchérit : « À ce moment-là, pour moi, là, il n’y avait aucun problème parce que c'est une adulte, je suis un adulte. Les deux, on était consentants. Pour moi, il n’y avait aucun doute dans mon esprit : je ne commettais pas de faute ».
La plainte, le choc
Pour Jacques, qui n’a jamais fait face à une plainte de cette nature en 27 ans de carrière, c'est le choc. « Ce qui me pendait au nez, c’était la fin de ma carrière. Si j’étais condamné, les gens allaient penser que j'avais été accusé d'abus sexuels. Tout notre univers a basculé ».
« Je sais très bien qu'un professionnel ne peut pas avoir de relations avec ses clients. Tout le monde sait ça, ajoute Sophie. Mais moi, je n'étais pas sa cliente. Techniquement, l’Ordre doit protéger le public. Je ne suis pas à protéger. Donc, ça n’avait aucun sens ».
Dans sa plainte, le syndic invoque l’article 59.1 du Code des professions. Jacques Létourneau est donc accusé, comme Pierre Faubert, d’avoir « abusé de la relation professionnelle pour avoir des relations sexuelles avec la personne à qui il fournit des services (...) durant la durée de la relation professionnelle ». Ce qui constitue, au sens déontologique, « un acte dérogatoire à la dignité de sa profession ».
Depuis 2017, une condamnation entraîne la perte quasi automatique du droit de pratique du professionnel pendant cinq ans. La sanction peut cependant être réduite selon la gravité des faits et de la collaboration du professionnel.
« Le syndic a un rôle important à jouer, rappelle le professeur de déontologie en psychologie Louis Brunet, parce que c'est lui, en dernière ligne, qui va s'assurer que les psychologues agissent correctement, en tout respect de la loi et de la déontologie envers leur client ».
Le Code des professions s’applique à tous les membres des ordres professionnels du Québec. Techniquement, un avocat, un ingénieur ou une diététiste ne peuvent donc pas entretenir une relation amoureuse ou sexuelle avec un client.
Les procédures contre Jacques Létourneau dureront cinq ans. Pendant lesquelles, en principe, il se doit de collaborer avec le syndic. Le professionnel n’a pas le droit au silence, sous peine d’être accusé d’entrave.
« Entre un accusé au criminel et un professionnel accusé en disciplinaire, j’aime mieux défendre un criminel », affirme l’avocat Robert Brunet, spécialiste en la matière depuis 50 ans. « Celui qui est accusé au criminel, il a plus de droits que le professionnel! »

C’est Robert Brunet qui défendra Jacques Létourneau dans les longues procédures avec le syndic de l’Ordre des psychologues.
« À un moment donné, je me suis choqué, se rappelle Jacques. Je me suis levé et j'ai dit : c'est terminé, à partir de maintenant, on arrête ça. J'ai un avocat, amenez-moi devant le tribunal ».
Il a alors cessé de collaborer avec le syndic.
« C'était clair pour moi qu'ils avaient franchi une limite dans leurs questions répétitives. Ils m'ont fait venir dans leur bureau au moins cinq à six fois avant que je me fâche ».
Le pire moment pour sa femme, Sophie? « C'est quand ça sonne, tu vas ouvrir la porte et que l’huissier te tend un subpoena. C'était le syndic qui me demandait d'être témoin. J'étais humiliée. Ça n’avait pas de sens : moi, je deviens le témoin contre mon conjoint! »
C’est par le biais d’un subpoena livré par huissier qu’Adèle Gélinas a aussi été convoquée au procès disciplinaire de son nouveau conjoint, Pierre Faubert.
« C'est très infantilisant. Je n’ai aucun pouvoir, aucun contrôle sur la situation. C’est mon ex-conjoint qui fait la plainte, le syndic qui s'en occupe en son nom, et moi, je suis juste un témoin », explique Adèle.
Adèle contre Adèle
Adèle Gélinas est ressortie traumatisée de sa rencontre avec la syndic de l’Ordre des psychologues. Elle s’y était rendue pour donner sa version et expliquer qu’elle avait librement consenti à sa relation avec Pierre Faubert, qui avait débuté après la fin de sa thérapie.
« On m’a demandé si j'avais eu des relations sexuelles, on m'a demandé si j'avais embrassé mon psychologue, comment ça s'était passé à la fin de la thérapie. Vraiment, on ratisse large », se rappelle Adèle.
Et surtout, on brandit son propre journal contre elle.
La syndic lui demande si elle reconnaît les papiers qu’on lui tend. « J’ai dit, oui, je reconnais, ça, c’est à moi ».
Il s’agissait des pages photocopiées de son journal intime « dérobé par son ex-conjoint », comme le confirmera plus tard la décision disciplinaire à l'endroit de Pierre Faubert.
« J'ai pleuré, dit Adèle. Il y avait toutes mes pensées les plus intimes là-dedans et tout le monde l’a lu. Je ne peux pas croire (que la syndic) avait le droit d’accepter ça ».
« Je n’ai jamais été aussi mal à l’aise de lire une preuve », se souvient l’avocate de Pierre Faubert, Jacqueline Bissonnette. « On n’avait pas d’affaire à lire ça. Cette dame-là a subi une forme de viol », estime-t-elle.
L’avocate a par la suite réussi à faire exclure le journal intime lors d’une étape ultérieure. « Le syndic n’avait pas à accepter une preuve acquise illégalement, insiste-t-elle, surtout qu’il avait d’autres moyens de faire sa preuve ».
La loi confère de larges pouvoirs au syndic, qui lui permettent, en principe, de recueillir tous les documents nécessaires pour déterminer si une faute a été commise.
Malgré cela, le syndic serait allé trop loin dans ce cas, estime le journaliste et chroniqueur Yves Boisvert, lui-même diplômé en droit.
« Même en droit civil, c'est très contestable, souligne-t-il. Parce que là, il y a une violation de la vie privée. Oui, le mandat du syndic est de protéger le public, mais pas à n'importe quel prix ».
« C'est assez spectaculaire comme manœuvre de le faire à l'insu de cette femme. Surtout pour lui faire dire ce qu'elle ne reconnaît pas, c'est-à-dire : vous êtes une victime, même si vous ne le pensez pas », dit le chroniqueur Yves Boisvert.
Contrer la complaisance
Dans les années 2010, Yves Boisvert a souvent dénoncé l’indulgence des syndics à l’endroit des professionnels reconnus coupables d’inconduite sexuelle, particulièrement les médecins.
« C’était toujours sur le même schéma, se rappelle-t-il. Le professionnel reconnaît sa faute et, en échange, il a une sanction de deux mois, trois mois, quatre mois, pour des infractions déontologiques décrites comme étant extrêmement graves ».
Comme certains médecins qui séduisaient, à répétition, des patientes en état de détresse.
À l'époque, le Collège des médecins prônait pourtant la tolérance zéro en la matière.
« Je me suis rendu compte que ce n'était pas tolérance zéro, c’était la complaisance absolue. (...) Pendant qu'en Ontario, les mêmes faits donnaient lieu à des sanctions automatiques de cinq ans de radiation! »
Chez les psychologues, à l’époque, les sanctions étaient tout de même plus sévères que pour les médecins, mais pas tant. Voyez ces deux cas : neuf mois de radiation pour un psychologue qui entreprend des relations sexuelles avec deux patientes en 2014; six mois pour cet autre qui fait des propositions sexuelles à sa cliente mineure dans son bureau en 2016.
En 2017, la ministre de la Justice Stéphanie Vallée fait adopter la peine minimale de cinq ans, dans la foulée de sa réforme du système professionnel. L’effet est immédiat : la moyenne des sanctions chez les psychologues passe de 21 mois à 4 ans et demi pour ceux qui sont reconnus coupables d’avoir « abusé de la relation professionnelle ».
Mais dans des cas comme celui de Pierre Faubert ou de Jacques Létourneau et de leurs conjointes, Yves Boisvert se demande bien ce que le syndic a cherché à sanctionner.
« Dans des cas semblables, on ne parle pas d'agression, on parle d'inconduite, on parle de zone grise, souligne-t-il. (Et) je pense que c'est un peu paternaliste que de dire à la personne : Non, vous, vous ne le savez pas, ça fait dix ans que vous êtes avec cette personne-là, mais vous êtes une victime. Vous l'ignorez, (mais) nous, on le sait mieux que vous ».
Nous avons sollicité les syndics impliqués pour avoir leur version des faits, mais leur devoir de réserve les empêche de répondre à nos questions. L’Ordre des psychologues a lui aussi décliné notre demande d’entrevue.
« J’ai jamais fait ça de ma vie »

Contrairement à Jacques Létourneau, Pierre Faubert a collaboré jusqu’au bout avec le syndic, notamment, en plaidant coupable à deux infractions : avoir permis « que s’établisse entre eux une relation intime » et en « ne gérant pas adéquatement les enjeux de transfert amoureux de sa patiente ».
« Il n’aurait jamais dû y avoir d'autres rencontres avec Adèle, ça aurait dû finir là, accorde-t-il. Et puis qu'elle poursuive sa vie et moi la mienne… »
Pierre a toutefois refusé de plaider coupable à la pièce de résistance, c'est-à-dire « l’abus de la relation professionnelle (...) pour avoir des relations sexuelles », comme le décrit l’article 59.1 du Code des professions.
« La notion d'abus, pour moi, c'est un geste qui est volontaire et intentionnel. Quelqu'un qui ferait ça, il mérite d'être radié pas quatre ans ou cinq ans, il mérite d'être radié à vie ».
« Le manipulateur prédateur qui prépare sa victime pour pouvoir la coincer et avoir des relations sexuelles avec elle, c’est pas moi. J'ai jamais, jamais fait ça de ma vie. Jamais », dit Pierre Faubert.
Adèle, sa conjointe, dénonce le portrait que trace d'elle la décision disciplinaire, qui la décrit comme une personne « très vulnérable », une façon de la voir qu’elle rejette jusqu’à ce jour.
« Je n’ai jamais senti qu'on avait tenu compte de mon opinion ou de ce que j'avais vécu. C’est comme si on voulait me faire entrer dans un moule, le moule de la victime ».
Un acquitté, l’autre pas
Jacques Létourneau a été acquitté en 2021. Le conseil de discipline a déterminé que Sophie était une « cliente secondaire » et ses enfants, des clients primaires.
Sa défense lui aura coûté plusieurs centaines de milliers de dollars. C’est l’assurance qu’il a contractée au début de sa carrière de psychologue qui lui a remboursé une grande partie de ses frais juridiques. Et, ajoute-t-il, qui lui a sauvé la vie.
« J'ai été acquitté parce que je pouvais me défendre, parce que j'ai pu avoir un avocat. Mais sans rien de tout ça, j'étais mal pris, là. Le manque d'argent m'aurait amené à plaider coupable ou à dire : OK, j'abandonne. Ce n’est pas la vérité qui serait ressortie. Et c'est ça qui est malheureux ».
Et si Jacques souhaitait porter plainte contre le syndic, il ne le pourrait pas. Car les syndics ne sont pas soumis à un code de déontologie.
Mais ça pourrait changer. Selon nos sources, un projet de code serait actuellement dans les cartons de la ministre Sonia LeBel.
Pour l’avocat Robert Brunet, il est plus que temps que cette lacune soit corrigée.
« Tant que les syndics n'auront pas un code de déontologie, tant qu’ils ne seront pas contrôlés, la situation ne changera pas. Parce que la journée où un syndic va avoir un code de déontologie, il va se tenir les fesses plus serrées », dit Me Brunet.
Pierre Faubert a été condamné à quatre ans de radiation et à 7500 $ d’amende. La décision de janvier 2024 lui reproche notamment d’« avoir profité des sentiments amoureux de madame » sans plus d’examen critique, alors que sa longue expérience professionnelle aurait dû le rendre plus vigilant. D’autant plus, précise-t-on, qu’il la savait « en pleine crise conjugale ».
En juillet dernier, il a vidé son bureau, à regret, fermé ses dossiers et averti ses clients qu’il fermait sa pratique. Il ne croit pas qu’il reprendra le collier en 2028 à la fin de sa radiation. Il aura alors 79 ans.
« De toute façon, dit-il, qui va vouloir travailler avec une personne reconnue coupable d'inconduite sexuelle? »
Son amoureuse l’admet : tout ce processus a été très difficile pour le nouveau couple. En parler avec Enquête a ravivé des souvenirs douloureux, mais Adèle ne regrette rien.
« Tu sais, on parle beaucoup de femmes qui ont de la difficulté à se faire entendre quand elles vivent du harcèlement ou subissent de la violence conjugale. Mais moi, c'est le contraire que j'ai vécu. Je ne me considère pas une victime d'un abus, mais on me dit que j'ai été victime d'un abus. Donc, c'est pour ça que je le fais aussi, pour qu'on voie l’envers de la médaille ».
Ils sont toujours ensemble.