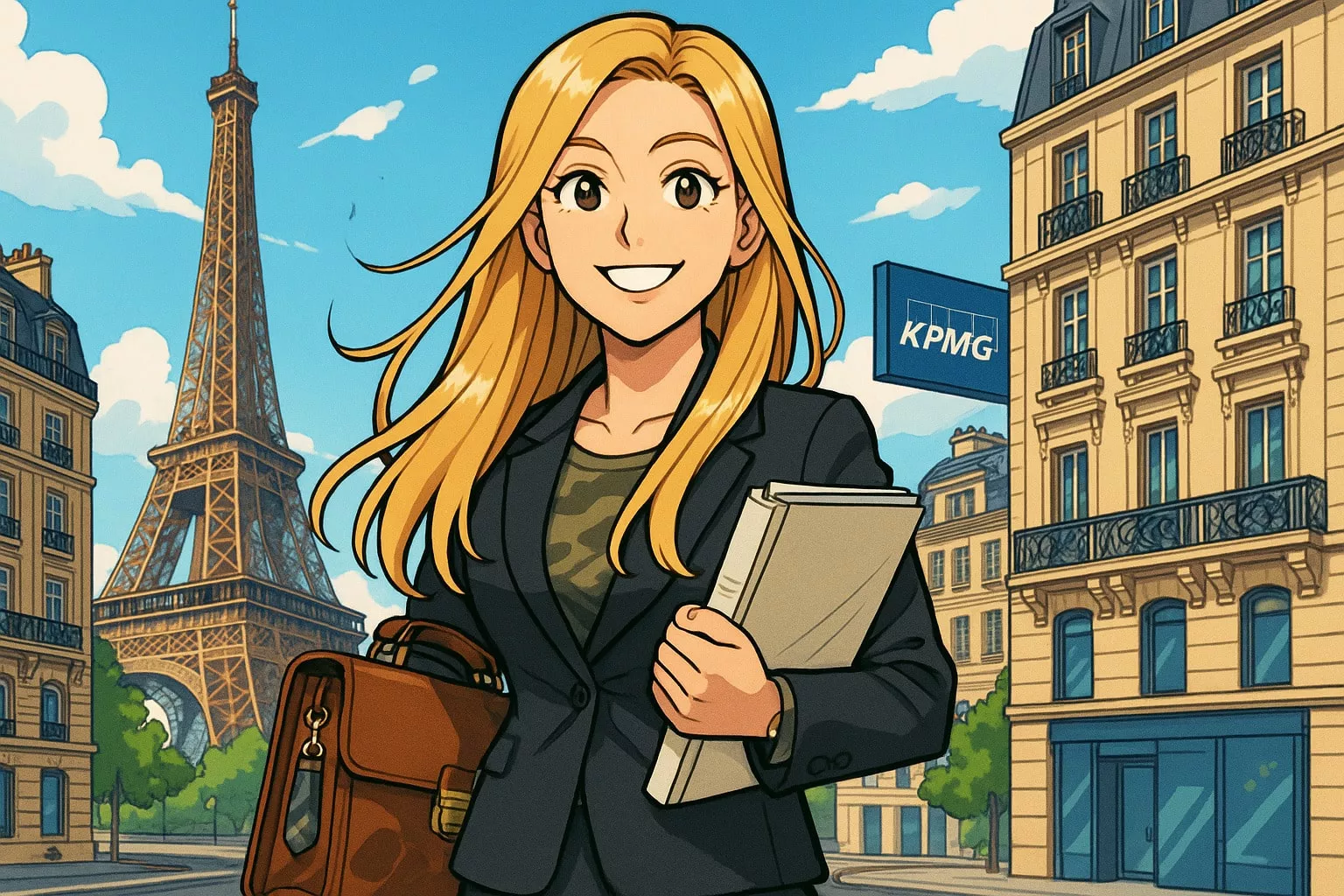L’arrêt des procédures n’est pas la solution dans l’affaire Normandeau

Bruno Gélinas-Faucher
2020-07-27 14:15:00

L’arrêt Jordan de la Cour suprême a créé une véritable révolution en fixant de strictes limites de temps pour la tenue de procès. Mais Jordan n’a pas pour autant réglé définitivement tous les aspects entourant la question des délais excessifs. La Cour a notamment laissé en suspens la question du type de réparation pouvant être ordonné en notant qu’« on ne (lui) avait pas demandé » de se pencher dessus.
Il est pour le moins surprenant que cette question ne reçoive pas plus d’attention dans le débat public. Après tout, ce ne sont pas les limites fixées par l’arrêt Jordan qui soulèvent l’indignation, mais bien la conséquence qui en découle lorsqu’on ordonne l’arrêt des procédures. Cette conséquence semble d’autant plus radicale qu’on constate que plusieurs autres démocraties occidentales permettent à leurs tribunaux de choisir parmi une panoplie de remèdes moins draconiens : exclusion de preuve, accélération des procédures, réduction de la peine, etc.
Si la question des remèdes n’a pas été abordée dans Jordan, il faut remonter aux années 1980 pour voir que la Cour suprême s’est elle-même contredite lorsqu’elle s’est penchée sur la question. Dans l’affaire R. c. Rahey de 1987, la Cour jugea que l’arrêt des procédures était la seule option possible pour remédier aux délais excessifs. Toutefois, moins d’un an avant, une majorité de juges avaient conclu dans l’affaire Mills c. La Reine que les tribunaux pouvaient opter pour d’autres options moins sévères, comme on le voit chez nos pays voisins. L’un des juges soulignait alors que l’arrêt des procédures était une « réparation draconienne » qui devait être réservée uniquement « aux cas les plus criants ».
Pour répondre à cette jurisprudence contradictoire, le procureur général du Canada se présenta comme intervenant devant la Cour suprême durant les années 1990 pour demander que l’on élargisse la gamme de remèdes disponibles. La Cour n’a toutefois jamais répondu à la demande puisqu’elle a conclu à l’absence de délais excessifs dans les causes en question.
En suivant l’exemple du procureur général, le Directeur des poursuites criminelles et pénales devrait à nouveau soulever cette question lors de sa défense contre une requête de type Jordan. Les tribunaux seraient alors forcés de déterminer s’il est approprié d’ordonner d’autres types de remèdes pour pallier les délais excessifs. Les commentaires de la Cour suprême dans l’arrêt Jordan laissent présager qu’elle est disposée à réévaluer la question. Les risques associés à cette démarche sont pratiquement nuls puisqu’une réponse négative viendrait uniquement confirmer le statu quo.
Il n’est toutefois pas impératif d’attendre la cause d’un accusé. Le gouvernement du Québec pourrait également être proactif et demander immédiatement à la Cour d’appel du Québec d’étudier la question par le biais d’un renvoi. C’est d’ailleurs la démarche qui était préconisée dans le rapport final du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles publié en juin 2017. Le Comité jugeait qu’il était primordial de reconsidérer la question des remèdes afin de pouvoir mieux gérer les répercussions de l’arrêt Jordan.
Peu importe la manière, il est plus que temps que la question soit remise à l’ordre du jour. Notre système opère sur la prémisse que l’arrêt des procédures est le seul remède pouvant pallier des délais excessifs subis par de présumés criminels. Mais ce cadre juridique est loin d’être coulé dans le béton. L’affaire Normandeau est l’occasion de passer à l’action et de recourir à d’autres solutions pour éviter l’arrêt des procédures.