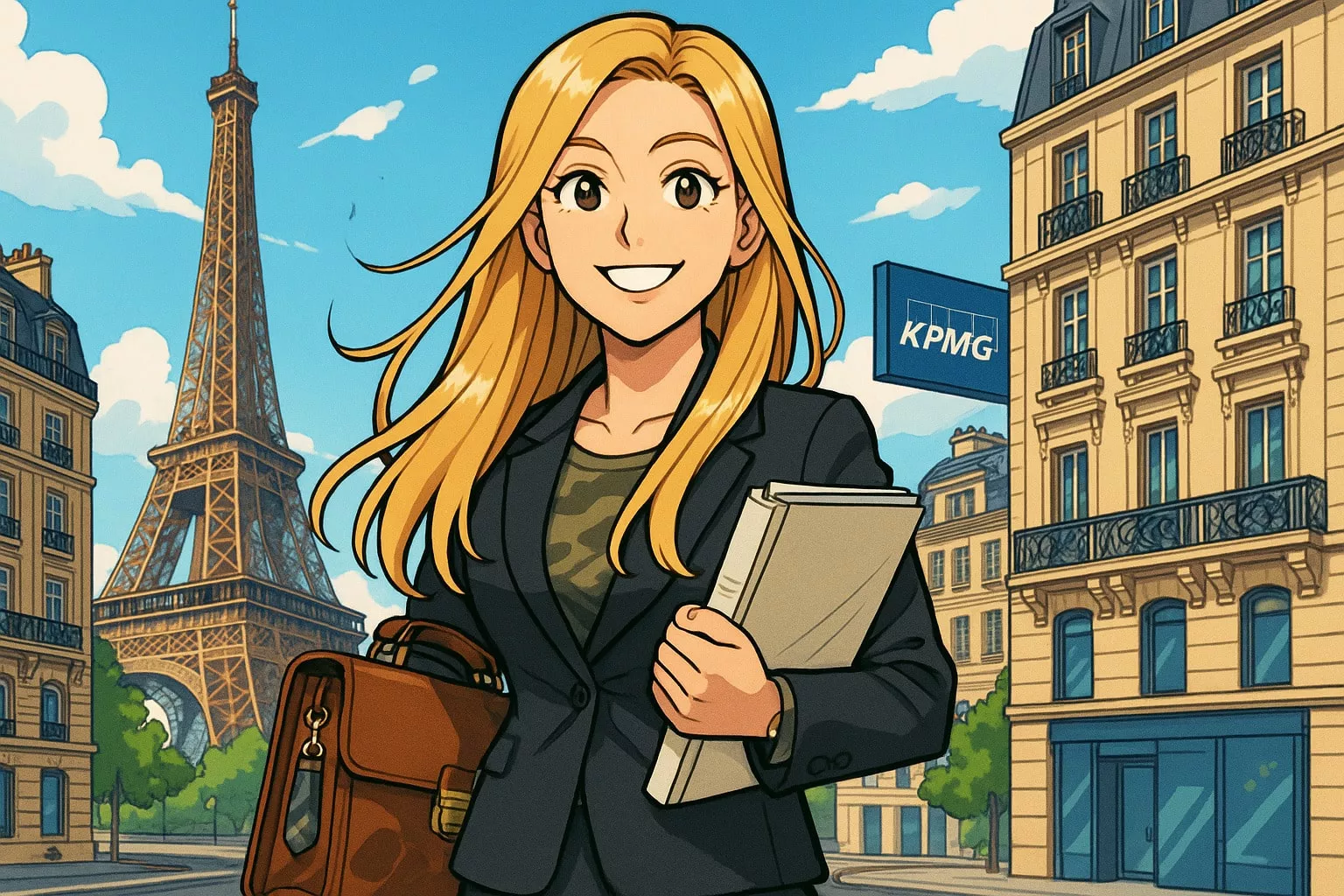Les illusions et confusions de l’accès à la justice

Lucie Lamarche
2016-12-15 10:15:00

Selon un rapport publié par l’Association du Barreau canadien en 2013, 48 % des Canadiens ne disposent pas des compétences requises afin de bénéficier, sans un accompagnement, de la masse d’informations juridiques déjà disponibles en ligne ou autrement.
On a célébré au Québec l’entrée en vigueur le 1er janvier 2016 des nouveaux seuils d’admissibilité économique à l’aide juridique. Ces nouveaux seuils auront pour effet de rehausser l’admissibilité à l’aide juridique au niveau du salaire minimum, ce qui n’a pas été fait depuis 30 ans. Un tel rehaussement est intimement lié à l’enjeu de l’accès à la justice.
En effet, l’intention première de l’aide juridique est de mettre à la disposition du citoyen les services d’un avocat afin de défendre ou de revendiquer certains droits, tant en matière civile que criminelle. Toutefois les services couverts par le système québécois de l’aide juridique comportent des limites importantes. Ainsi, en matière criminelle, les services requis aux fins d’une défense suivant des accusations qui ne sont pas a priori susceptibles de mener à une peine d’emprisonnement sont exclus. C’est le cas des infractions aux règlements municipaux.
En matière autre que criminelle, les services d’aide juridique pourront aussi être niés si le requérant a refusé une proposition raisonnable de règlement de l’affaire ou encore, lorsque les services pour lesquels cette aide est demandée peuvent être obtenus autrement, notamment par l’intermédiaire d’un autre service gouvernemental ou d’un organisme ou encore au moyen d’un contrat d’assurance.
Dans ce contexte, la hausse récente des seuils d’admissibilité à l’aide juridique au Québec ne répond qu’en partie aux exigences de l’accès à la justice à titre de composante de la règle de droit. Il est ainsi très difficile de mobiliser le droit pour d’autres fins que pour répondre aux besoins juridiques individuels d’un client. Nous ne croyons pas que les contraintes budgétaires, ou plus précisément encore, l’idéologie de l’austérité, expliquent à elles seules la parcimonie des régimes d’assistance judiciaire au Canada.
Car dorénavant, les plus vulnérables devront s’éduquer préventivement au droit tout comme on lutte contre l’obésité, le diabète ou le tabagisme, des « maladies de pauvres » qui entravent un exercice responsable de la citoyenneté. Et à cet égard, les initiatives de la société civile nagent en pleine confusion et sont partagées entre le sentiment d’urgence et, parfois, le sens de l’opportunité.
La philanthropie
Commençons par quelques exemples. Pro Bono Québec, un regroupement volontaire d’avocats, promeut l’idée de sensibiliser la communauté juridique à la problématique de l’accès à la justice et à l’importance de redonner des heures de services professionnels en soumettant à cette fin une demande au Comité pro bono. Pro Bono Québec a ses propres critères et favorise les causes d’intérêt public ou encore celles où un dommage irréparable est susceptible d’être causé.
Le réseau des Centres de justice de proximité du Québec se donne pour mission d’offrir des services gratuits d’information juridique, de soutien et d’orientation. Son financement est assuré par le Fonds Accès Justice du Québec. Clairement, ces initiatives contribuent à l’offre de justice officieuse. Mais comme le disait le juge Dickson en 1988, sans l’accès aux tribunaux, « la primauté du droit sera remplacée par la primauté d’hommes et de femmes qui décident qui peut avoir accès à la justice ».
Les pauvres dérangent
Confrontées à ce virage de « raisonnabilité » et de rationalité économique, les exigences de la règle de droit semblent rapetisser comme une peau de chagrin. Mais pourquoi ? En partie parce que le service public que constitue la justice, traitée comme un bien économique rare, se transforme au gré de l’offre en une justice officieuse moins rare. Et comme pour tous les biens abondants, cette justice-là est à la portée des moins bien nantis, voire des plus démunis. Ce constat est largement occulté par les théories qui valorisent une prise de contrôle personnelle (l’empowerment) sur son sort juridique. Ces théories de justice individuelle réduisent aussi à peu de chose le rôle politique du litige et du recours aux tribunaux.
Aussi, les pauvres dérangent le système de justice. Ils ne sont pas raisonnables et doivent apprendre, d’une part, à contrôler les conditions de leur déshérence juridique et, d’autre part, à se satisfaire de solutions simples et rapides qui correspondent à leur condition.