L’effet ravageur d’une dénonciation publique

Jean-Claude Hébert
2017-12-15 14:20:00

Techniquement, l’innocence présumée concerne l’administration de la preuve devant un tribunal pénal. Mais cette protection inhérente à une poursuite criminelle se double d’un droit civil protégeant la réputation et la dignité du citoyen vitupéré publiquement.
Discordance entre temps judiciaire et temps médiatique
Face au feu roulant du monde de l’information, il y a discordance entre le temps judiciaire et le temps médiatique. Condamner hâtivement un non-coupable sur la foi de lourds soupçons nourrit l’injustice. Par contre, considérer comme innocente une personne d’ores et déjà promise à damnation appartient à la foi aveugle.
La justice idéale devrait permettre de punir les coupables sur-le-champ, tout en épargnant les innocents. Cependant, cet idéal s’effrite devant la réalité de traitement des affaires judiciaires. Animé par le principe de précaution, le processus d’enquête et de mise en accusation procède avec lenteur. Cette retenue n’est pas sans vertu : elle favorise l’équité du procès et diminue la possibilité d’erreur judiciaire.
Selon la Cour suprême (arrêt Pearson), la présomption d’innocence est plus qu’un simple droit procédural. C’est un principe de justice fondamental garanti par la Constitution qui assure la sécurité d’une personne, notamment sa réputation et sa dignité.
Pour les esprits méfiants, la présomption d’innocence évoquée par ceux qui sont coincés dans une polémique ne serait qu’un prétexte pour contrer les dénonciations publiques. Plutôt qu’un principe de justice fondamental, dit-on, c’est une norme de prudence.
Pour les francs-tireurs de la justice médiatique, sommaire et sans appel, l’innocence présumée du citoyen cloué au pilori ne devrait jamais l’immuniser contre la réprobation sociale et la critique citoyenne.
La Constitution américaine et son interprétation inspirent les tenants d’une liberté d’expression illimitée. Cet instrument juridique diffère foncièrement de notre aménagement constitutionnel. La Charte canadienne impose aux tribunaux une obligation de pondération entre les droits et libertés fondamentaux garantis. Puisque la Cour suprême a développé des règles de proportionnalité, la liberté d’expression est forcément relative. Elle ne bénéficie d’aucun surclassement hiérarchique.
Dans les pays de common law (Grande-Bretagne, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada et Afrique du Sud), l’approche américaine de la libre expression hégémonique est non avenue. Ces pays démocratiques rejettent la protection d’une liberté d’expression qui sous-estime la réputation des personnes et la civilité dans la vie publique.
Dénonciation anonyme
Dans l’enceinte du tribunal, l’exigence de publicité prévaut sur le secret. La confrontation entre l’accusé et l’accusateur doit être équilibrée. Encore faut-il que le premier connaisse la face cachée du second.
L’administration de la justice pénale traite avec délicatesse la protection d’un dénonciateur anonyme. Un privilège relatif aux indicateurs de police existe depuis longtemps. En fournissant des informations inédites, parfois impossibles à dénicher, ils jouent un rôle essentiel pour débusquer les fripouilles.
Sous réserve de l’exception relative à la démonstration de l’innocence de l’accusé, le privilège crée une interdiction absolue de révéler l’identité d’un indicateur. La police, le ministère public et les tribunaux sont confinés au silence.
Selon la jurisprudence, le recours aux dénonciateurs anonymes renforce la protection du public.
La communauté médiatique devrait tenir compte de l’observation suivante formulée en 2016 par le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) sur le harcèlement et les violences à caractère sexuel en milieu universitaire : « Toute intervention auprès d’une personne mise en cause découlant de signalements anonymes devrait être faite dans les principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle. »
Concernant la dénonciation en milieu de travail, une note de recherche rédigée en 2007 pour l’École nationale d’administration publique (ENAP) soulignait l’importance d’avoir un mécanisme d’enquête accompli avec minutie, discrétion et confidentialité. On cherche à préserver les droits et la dignité des personnes interrogées.
À la Société Radio-Canada (Normes et pratiques journalistiques), l’identification d’une source est la règle, ce qui permet au public d’en évaluer la crédibilité. Le recours à une source anonyme ne doit être utilisé « qu’en une situation tout à fait exceptionnelle, lorsqu’il n’est pas possible par aucun autre moyen de diffuser une information jugée fiable et essentielle ».
Devoirs et responsabilités des médias
Autrement dit, le malaise, la gêne et l’embarras du dénonciateur anonyme ne coïncident pas avec une situation fortement exceptionnelle. Qui plus est, le diffuseur public impose à ses journalistes l’obligation suivante : le reportage doit mentionner pourquoi le privilège d’anonymat d’une source lui est consenti et dans quel contexte. Bref, le journaliste doit fournir le plus de précisions possible quant à l’origine et la fiabilité de l’information communiquée.
Selon la Cour européenne des droits de l’Homme (Springer c. Allemagne, 2012), l’exercice de la liberté d’expression comporte des devoirs et responsabilités pour les médias, même face à des questions d’un grand intérêt général : « Il doit exister des motifs spécifiques pour pouvoir relever les médias de l’obligation qui leur incombe d’habitude de vérifier des déclarations factuelles diffamatoires à l’encontre de particuliers. »
Et la Cour d’ajouter qu’une attaque à la réputation personnelle existe dans la mesure où elle atteint un certain niveau de gravité et qu’elle porte atteinte au respect de la vie privée.
Au final, c’est une affaire d’équilibre entre deux droits fondamentaux : l’expression libre d’un dénonciateur (par médias interposés) d’une part, et la réputation et la dignité d’un citoyen, d’autre part. Le curseur est forcément mobile.


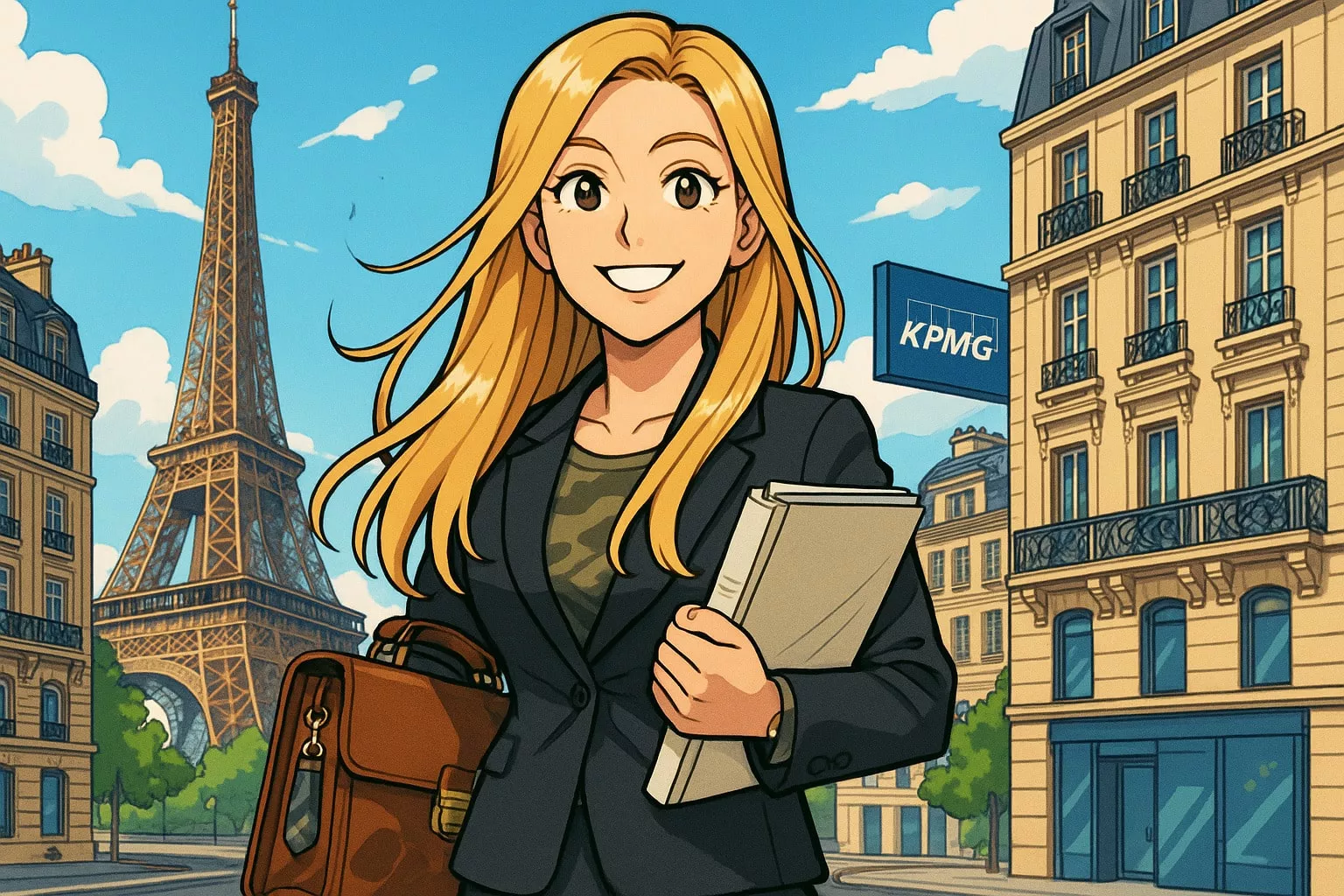







Le Gros Roger
il y a 7 ansTexte brillant et intelligible !
Anonyme
il y a 7 ansJe pense que la vague de dénonciation (anonyme ou non) dans les médias est le symptôme des problèmes de notre système de justice et du manque de confiance du public. Quand on regarde les délais épouvantables, sachant le stress inhérent à des procédures judiciaires de part et d'autres, quand on entend la façon dont ont été traitées certaines présumées victimes, ça ne donne pas tellement envie de dénoncer par les canaux judiciaires. Avec les médias sociaux et les médias conventionnels toujours plus avides de sensationnalisme, c'est tentant d'y aller avec cette solution... avec tout ce que ça implique de malsain pour le droit des accusés.
Zoro
il y a 7 ansL'effet des dénonciations des dernières semaine donne froid dans le dos. Coupable ou innocent, tous les présumés agresseurs sont cloués au pilori illico par la masse populaire trop contente de voir les héros devenir des zéros. Quand la poussière va retomber on verra combien de dénonciations étaient fausses ou mal fondées. Les gens semblent oublier toutes les fausses dénonciations des dernières années ...
Les réputations ne s'en remettront jamais par contre.
Solution : obliger les dénonciations d'agressions à être privées jusqu'à procès. Toute révélation publique avant jugement devrait être une infraction criminelle. Faut contre-balancer les médias sociopathes. Là il y aura peut-être une véritable présomption d'innocence.
Me
il y a 7 ansMalheureusement, nous vivons dans une société dans laquelle est permis la condamnation "journalistique" d'individu sur la foi de simples allégations prenant origine de dénonciations de la part de personne en mal d'un règlement de compte.
Sous le couvert de la liberté de presse, certaines personnes ont vu leur vie professionnelle, familiale et sociale détruites. Pensons seulement à la démission du No 2 de l'UPAC, la condamnation médiatique de Louis Coulombe, etc.