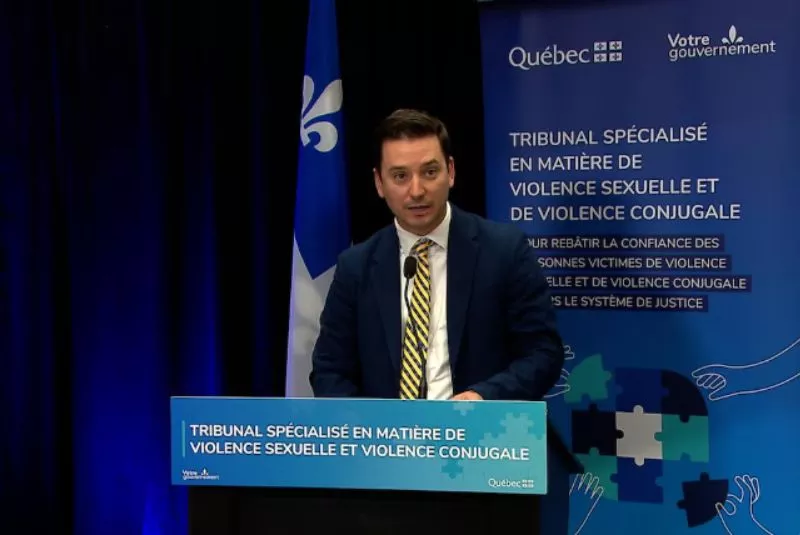La gauche québécoise ou l’autre droite (en passant par le fait français)

Frédéric Bérard
2011-12-07 14:15:00
Le temps des Fêtes. Heure à la réjouissance, aux souhaits et à la confession. En voici une qui, aux yeux de certains, aura des allures de lapalissade: je me veux plutôt méfiant du nationalisme ethnique, quel qu’il soit. Québécois ? Canadien ? Peu importe.
Einstein le qualifiait d’ailleurs ainsi : « nationalism is an infantile disease. It is the measles of mankind.» Bon. Le contexte dans lequel Einstein fut nécessairement particulier, s’entend. Sans aller aussi loin, disons que je m'éloigne farouchement de toute forme d’auto-gratulation jumelée, trop fréquemment d’ailleurs, à l’établissement d’une dichotomie malsaine entre le Nous et l’Autre.

À mon sens, le prisme du nationalisme ethnique amène trop facilement la dissertation excessive sur soi-même. Exagérer la portée réelle des évènements. À amplifier la portée réelle de nos réalisations et à faire porter aux autres le poids de nos échecs. À exacerber simultanément chauvinisme et déresponsabilisation.
La gauche québécoise ou l’autre droite
Une généralisation, répandue à souhait et issue de ce nationalisme obtus : ‘’le reste du Canada est à droite, le Québec à gauche’’. Contrairement à ce même ROC, nous sommes d’un progressisme absolu. Plus ouverts, moins repliés sur nous-mêmes. Plus réhabilitation, moins incarcération. Yeah right.
Quiconque a lu récemment les chroniques du journal le plus populaire de la province sait que cette présomption relève du délire pur et simple. Systématiquement la même marotte : le gouvernement-maman. La perte de notre identité provoquée par notre caractère prétendument "mollasson" face à l’immigration. Les criminels possèdent trop de droits. Les sentences bonbons. La Charte des bandits. L’omniprésence des droits de l’hommistes de mon espèce (l’expression, horrible, n’est pas de moi).
Après-coup, on osera plaider que la Loi C-10 est refusée au Québec du fait de notre approche collectivement progressiste. Bien sûr. J’imagine qu’on parle ici des tonnes de supporteurs du sénateur Boisvenu, aux innombrables lecteurs des chroniqueurs susmentionnés ou encore aux dizaines de milliers de Québécois qui auraient souhaité que Guy Turcotte soit cloué au au poteau plutôt que de conclure à sa non-responsabilité pénale. Ceux-ci sont d’ailleurs bien appuyés : difficile de regarder un épisode d’affaires publiques des pendants télévisuels de l’empire sans se faire plaquer les arguments simplistes, voire démagogiques. S’ajoutent aussi bon nombre de radios populistes et proportionnellement populaires, notamment la puissante X de Québec. La CAQ. L’ADQ (qui est déjà passée à un cheveu de former le gouvernement). Le PLQ. Le PQ, dans une mesure moindre. À gauche, vraiment ?
Pour un Khadir, combien d’apprentis Legault ?
Bon. Où vais-je avec tout ceci ? Un peu comme les indignés du Square-Victoria, disons que je sais ce que je refuse, même si j’ignore ce que je souhaite précisément. Ceci dit, oui, j’aimerais bien un truc, et pourquoi pas pour Noël : vivre dans une société plus mature, plus confiante, plus sereine, plus assumée, surtout. Moins accusatrice, moins hystérique. Une illustration ? Certainement.
Le français ou la maitrise de notre destin
Maître chez nous, disait Jean Lesage et son équipe du tonnerre. Parmi les composantes essentielles, voire impératives, de ce même objectif : assurer le fait français dans les milieux de travail. Promouvoir du même coup l’essor francophone en matière économique et, plus précisément, dans le domaine de la finance, secteur opaque s’il en est un. Au menu, création d’outils au même effet, notamment la Caisse de dépôt. Difficile d’être contre un levier du même genre, on en conviendra. Quiconque minimalement informé en viendra à conclure, cinq décennies plus tard, aux bénéfices directs quant à la fusion franco-économique de la chose.
Ceci dit, depuis deux semaines, branle-bas de combat. Après vives recherches, des journalistes découvrent le pot-aux-roses : deux cadres de la Caisse de dépôt sont unilingues anglophones. Une pléiade d’articles est consacrée au sujet. Exclusif, titre-t-on. À la une. Plusieurs jours de suite. On apprend même, ô sacrilège, qu’un de ces cadres fait l’école buissonnière en refusant de se pointer à ses cours de français sur une base régulière. Le feu est maintenant pris dans la cabane (au Canada). Pressé de toute part par les médias et une opposition en manque de scandale, le premier ministre se doit d’obliger la Caisse de prendre des mesures coercitives, ce qui est aussitôt fait. Finies, les folies.
Ce n’est pas tout. Alimentés par des lecteurs avides de règlement de comptes, nos journalistes poursuivent leur chasse à l’Anglais. Et ils ne reviennent pas bredouilles. « Arrêtez les presses ! On vient de débusquer un autre Anglais !». De la Banque nationale, celui-là. En finances, évidemment.
Pour ceux et celles qui n’ont pas encore saisi mon sarcasme, je vous rassure, c’en est bel et bien. Ça m’amuse ? Pas vraiment. En fait, ça m’attriste. Et je ne parle pas ici de la partie de chasse médiatique, hystérique et démagogique entourant l’opération. Ce qui me désole davantage, ce sont les conclusions larmoyantes ou outrées de certains autres chroniqueurs de renom. Que défendent-ils ? Ceci : nous avons enfin la preuve que le français recule au Québec, et ce, malgré tous les efforts consentis. Offusquons-nous.
Pleurons de découragement et lassitude. La partie est perdue. L’Anglais, avec un grand A, vient de remporter la victoire. Par preuve, jamais le capitaine du Canadien de Montréal n’aurait pu, pendant les années 80, être unilingue anglophone. Le fait qu’on élude prétendument aujourd’hui cette question pourtant fondamentale n’est-elle pas la preuve ultime du je-m’en-foutisme linguistique ambiant ?(2)
Entre l’anecdote et la réalité
Retour sur terre : qui peut sérieusement prétendre au déclin de la participation francophone en matière de finances et/ou économie ces jours-ci ? Qui n’a pas entendu parler des Coutu, Vachon, Ménard, Beaudoin, Brochu, Leroux, Péladeau ? Qui n’a pas entendu parler, dans un français quasi-impeccable, les Bronfman, Molson, Johnson ? Bien sûr, quiconque pourra sortir d’un chapeau une anecdote perso afin de contredire mon propos. L’iconique grosse madame de chez Eaton, par exemple. De bonne guerre, je répliquerai qu’en quatre ans chez Stikeman Elliott, je ne me souviens guère d’un associé anglophone incapable de me donner ses instructions dans ma langue, moi, jeune avocat issu des régions parlant d’ailleurs un anglais épouvantable. Empathie ? Culture de bureau ? Nouvelle réalité socio-linguistique ? Je ne sais trop. Ce que je sais, par contre, c’est qu’il me semble pour le moins inique de prétendre, encore de nos jours, à la suprématie de l’unilingue anglophone en milieux d’affaires montréalais. Prédominance du bilinguisme ? Certes. Mais est-ce si terrible ?
Ceci dit, les grands pourfendeurs du fait anglais ne semblent aucunement réaliser l’extrême ironie de leur propos : toutes ces enquêtes journalistiques, couteau entre les dents, ont permis de mettre le grappin uniquement sur trois cadres de la haute finance montréalaise. Trois. Oui, trois. Et des mesures ont été prises ipso facto pour « palier à la situation ».
Par conséquent, il m’appert qu’on pourrait raisonnablement y voir une preuve minant la thèse proposée. Que selon toute vraisemblance, on pourrait y voir un signe de la vitalité du français, et ce, à même un secteur traditionnellement peu enthousiaste à la diversité linguistique. Que la maitrise de notre destin, comme le souhaitait Lesage, est peut-être chose faite, du moins dans son essence. Il s’agit, il me semble, du constat que ferait toute société confiante, sobre et sans complexe. Mais il est évidemment plus excitant, et surtout plus payant côté tirage, d’écrire que le loup est non seulement dans la bergerie, mais qu’il est en train de bouffer le troupeau de moutons pure laine en place.
Ainsi, et puisque je ne crois plus au Père Noël (depuis peu, faut dire), je passerai mes prochaines vacances au Lac Kataway. Dans le bois le plus absolu. Entouré de la faune animale. Ni franco, ni anglo. La paix. Je nous souhaite collectivement la même chose.
(1) Un peu de culture hockey aurait permis au chroniqueur de savoir que tant un directeur-général (Irving Grundman) qu’un entraîneur-chef (Bob Berry) représentaient précisément l’unilingue anglophone tant décrié aujourd’hui.
(2) Je suggère en effet de demander à Saku Koivu ce qu’il en pense.