Cinq minutes d’utilisation et 400 ans pour disparaître…

Amélia Salehabadi
2007-09-05 10:51:00
Pourquoi est-ce si important d’éradiquer complètement ces sacs dans le monde ? Pas seulement pour une question d’environnement, mais aussi pour une raison de santé publique.
Aussi, le simple fait qu’il faut près de quatre siècles pour dégrader complètement un sac en plastique, ajouté à l’idée que ce processus permet souvent la lixiviation (percolation lente de l'eau à travers le sol, accompagnée de la dissolution des matières solides qui y sont contenues) de métaux lourds et autres contaminants chimiques, sont autant d’arguments favorables au remplacement de ces sacs et autres suremballages, par des objets nettement plus écologiques.
Ouf ! Le débat sur l’utilisation des sacs en plastique vient véritablement d’être lancé au Québec et il était temps !
Mais comment faut-il s’y prendre pour sensibiliser complètement les consommateurs québécois à l’importance de refuser ces sacs et les commerçants, de ne plus en proposer du tout ?
Thomas Mulcair a dit non !
Oui, le Québec a du retard en la matière. En 2005, le député Tremblay, du Lac-St-Jean, a tenté, en vain, de légiférer, en soumettant à l’Assemblée nationale, le projet de loi 390 «Loi interdisant la distribution de sacs en plastique non biodégradables».
Et devinez qui s’est opposé à cette loi ? Nul autre que le ministre de l’environnement de l’époque, Thomas Mulcair. Ce dernier a basé son refus sur deux raisons principales: l’existence du système de redevances sur les emballages mis en place par le projet de loi 102 et l’article 53.28 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), qui donne au gouvernement le pouvoir de réglementer la fabrication de contenants et d’emballages.
En somme, il semblerait, d’après Thomas Mulcair, que ces dispositions représentaient déjà l’essentiel du projet de loi 390, qui devenait alors tout simplement superflu.
Eu égard à l’opinion de l’ancien Ministre Mulcair, il nous apparaît, bien humblement, que le projet de loi 102 ne constitue pas une action gouvernementale suffisante pour ralentir l’utilisation des sacs en plastique. Adoptée en 2002, cette loi a uniquement pour objectif de partager les coûts de la cueillette sélective entre les municipalités et les générateurs de matières résiduelles.
Ces derniers doivent payer des redevances annuelles aux municipalités en fonction du poids des matières utilisées. A l’échelle d’un seul produit, ces redevances sont extrêmement faibles et aux dires de l’ancien Ministre Mulcair lui-même, n’affectent aucunement les consommateurs. Il suffit d’aller dans n’importe quel commerce du Québec, à quelques exceptions près, pour constater que les sacs en plastique sont encore très et trop présents.
Bannissements, taxes, normes de fabrication
Ainsi, l’exemple d’autres pays (voir encadré), prouve que pour avoir un effet dissuasif certain vis-à-vis de l’utilisation massive, par les consommateurs, des sacs en plastique, trois mesures principales doivent être mises en place : les bannissements, les taxes et les standards de fabrication minimaux.
Par ailleurs, il est primordial d’informer et de préparer la population aux changements envisagés. La taxe irlandaise, bien que payable par le consommateur, a été relativement bien accueillie par les gens car elle était accompagnée d’une campagne de sensibilisation. L’Afrique du Sud a, quant à elle, ouvert une ligne téléphonique, sans frais, pour répondre aux diverses questions et constitué une société sans but lucratif pour promouvoir la réduction des déchets et conscientiser l’industrie du plastique.
Nous estimons également que la taxe payable par le consommateur devrait être suffisamment élevée pour décourager efficacement « l’achat » de sacs en plastique.
Au risque de déplaire aux environnementalistes chevronnés, il faut aider l’industrie du plastique à se faire hara-kiri, ne serait-ce que pour tous les emplois encore générés par cette dernière.
A ce titre, deux approches émergent des exemples internationaux: l’octroi d’un support financier à l’industrie (France) ou d’une période de grâce avant l’entrée en vigueur complète de la loi (Afrique du Sud). Notons néanmoins qu’une diminution de la production et de l’utilisation des sacs en plastique, pourrait favoriser le développement d’autres industries, comme au Bangladesh où celle du sac en jute a ressuscité.
Pour en revenir à l’exemple du Québec, le refus du Ministre Mulcair n’a fort heureusement pas clos le débat sur les sacs en plastique dans la province. A contrario, la polémique autour du projet de loi 390 a permis au public d’être mieux informé et de se sensibiliser d’avantage à cette cause. Pour preuve, la popularité des sacs réutilisables ne cesse de grandir. De plus, une pétition à l’appui du projet de loi 390 a été lancée par l’organisme ÉcoContribution et a recueilli plus de 100 000 signatures. Un autre exemple du souhait de la population québécoise de voir le gouvernement agir sur cette question.
Il faut également souligner que Monsieur Jacques Lalonde, fondateur d’ÉcoContribution, a proposé au gouvernement d’imposer une « écotaxe » de 20 sous sur chaque sac en plastique distribué. Cette mesure aurait, sans aucun doute, un effet fort dissuasif sur les consommateurs.
Mais est-ce suffisant ? Nous avons des doutes… Et vous ?
Encadré
Exemples de mesures législatives étrangères sur les sacs en plastique :
Bannissements
• Afrique du Sud: Bannissement des sacs en plastique dont l’épaisseur est inférieure à 30 microns. Les sacs plus épais et plus facilement recyclables doivent être achetés par les consommateurs.
• Taïwan: Le bannissement a été imposé de manière graduelle. Il ne concernait tout d’abord que la distribution des sacs par les agences gouvernementales, les écoles et l’armée. Il a, par la suite, été étendu aux supermarchés, aux établissements de restauration rapide et aux magasins à rayons. On envisage ajouter à cette liste, les vendeurs de rue et les marchands de nourriture.
• Erythrée: Un individu qui a en sa possession un sac en plastique n’est pas puni, mais il doit déclarer aux autorités où il l’a obtenu.
• Somalie: L’utilisation de tout type de sacs en plastique a été bannie après une période de grâce de 120 jours, pour permettre au public de se débarrasser de ses stocks.
• Autres pays bannissant totalement ou partiellement les sacs en plastique: Bangladesh, Bhoutan, Botswana, Rwanda et Tanzanie.
Taxes
• Danemark: Taxe payée par les détaillants. Ces derniers encouragent l’utilisation des sacs réutilisables.
• Irlande: Taxe payable par le consommateur. La taxe a été augmentée dernièrement car elle n’était plus suffisante pour dissuader les consommateurs.
• Autres pays imposant une taxe sur les sacs en plastique: Finlande, Italie, Suède, Suisse, et Australie (Etat de Victoria seulement).
Standards
• Afrique du Sud: Réglementation sur l’épaisseur du sac et sur la superficie pouvant être imprimée.
Amelia Salehabadi est la fondatrice et l'Associée principale de Salehabadi, Cabinet d'avocats, de Montréal. L’auteure remercie, pour leur précieuse collaboration, Me Prunelle Thibault-Bédard et Mme Joanne Beauvais.


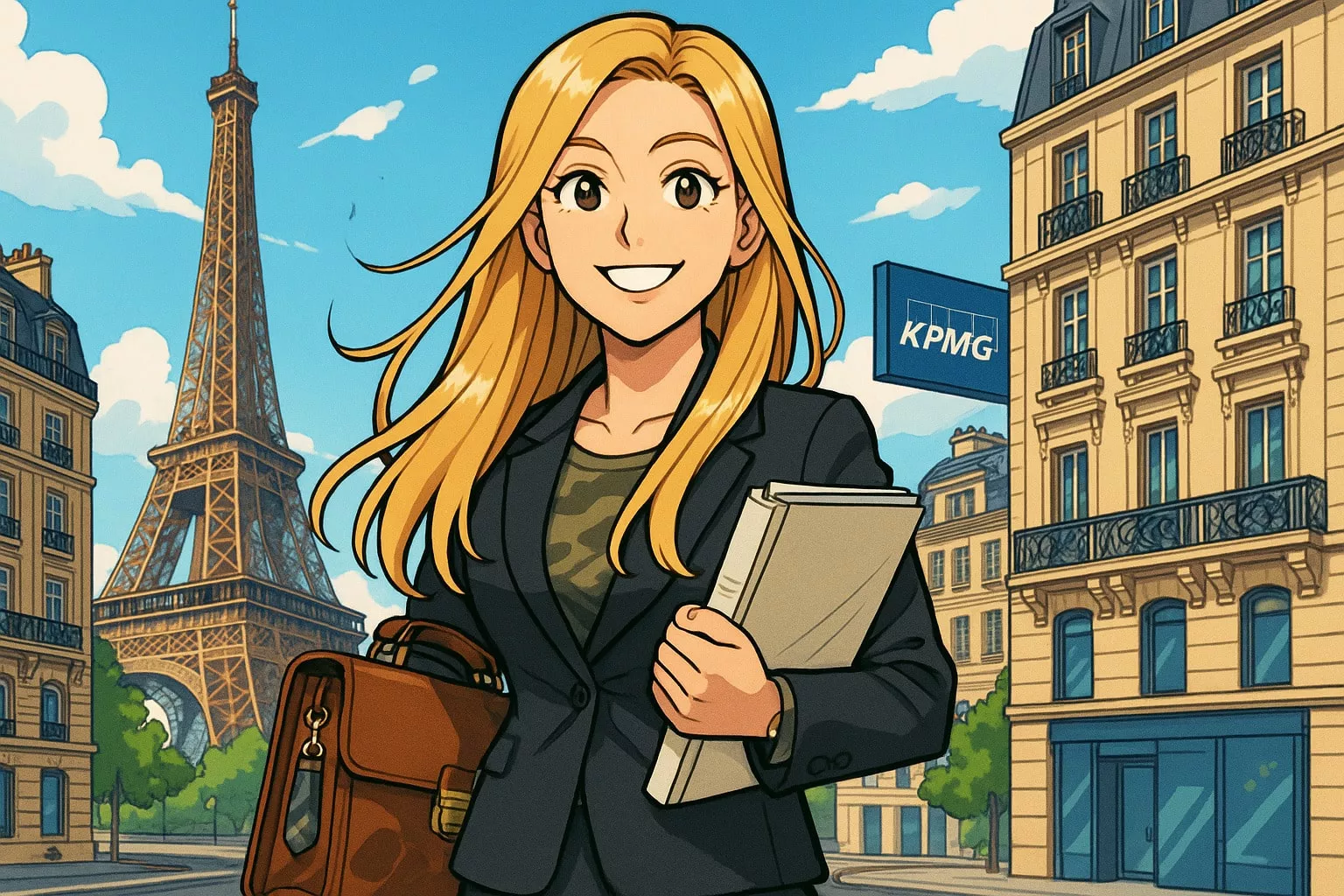









Anonyme
il y a 17 ansMe Salehabadi, vous avez su, avec vos collaboratrices, survoler ce dossier complexe et d'actualité!